« Chaque ligne que j’écris (…) éveille en moi une angoisse et une inquiétude indicible », écrit en 1943 Sándor Márai, qui assiste à la nazification de son pays. Nous avons rencontré sa traductrice, Catherine Fay, à l’occasion de la sortie en français du premier volume du « Journal » de l’immense écrivain hongrois, qui brosse le portrait d’un pays et d’une société en prise avec ses démons et révèle une facette plus intime de l’auteur.
« Je suis né écrivain, c’est tout ; un jour, semble-t-il, il faut accepter ce destin avec toutes les conséquences qu’il suppose. » (Sándor Márai, 1943)
Écrivain reconnu de l’entre-deux-guerres en Hongrie, auteur de nombreux romans et nouvelles, de pièces de théâtre et de chroniques journalistiques, Sándor Márai entame en 1943 l’écriture d’un journal qu’il tiendra jusqu’à peu avant sa mort en 1989. La Hongrie est alors relativement épargnée par la guerre, mais l’alignement de plus en plus étroit du régime de l’amiral Horthy puis des Croix fléchées avec les idées et les pratiques fascistes poussent l’écrivain à opter pour le silence public.
Les éditions Albin Michel publient ce mois-ci en traduction française le premier volume du Journal, qui rassemble sur 540 pages une sélection des entrées des quatre volumes de l’édition complète hongroise pour la période 1943-1948. A travers les notes prises au fil des jours de la guerre, de la libération puis de la mise en place du nouveau régime communiste, apparaissent non seulement quelques facettes de l’homme derrière l’écrivain, mais aussi un portrait d’un pays et d’une société en prise avec ses démons. Retour, avec sa traductrice, Catherine Fay, sur la genèse du Journal et sur sa traduction française.
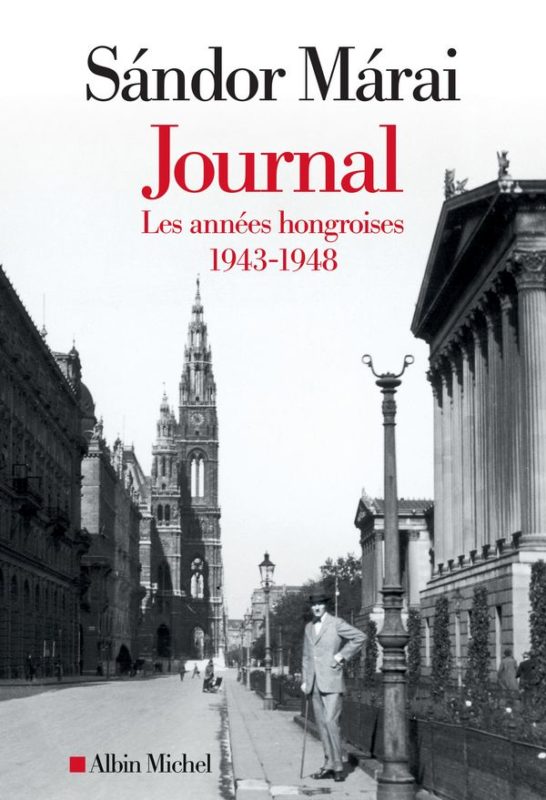
« Márai n’explique pas, dans son Journal, ce qui le pousse à l’écrire à partir de 1943. Cependant il était jusque-là dans un autre mode d’expression, avec l’écriture de textes de fiction, de chroniques pour les journaux, de pièces de théâtre. S’il commence à écrire ce journal, c’est parce qu’il ne peut plus s’exprimer autrement », explique sa traductrice, Catherine Fay. A partir de 1944, il lui devient en effet très difficile de publier, à cause de la guerre d’abord, puis du changement de régime avec l’occupation allemande du pays en mars 1944. Le journal devient alors un exutoire pour Márai, qui ne peut ni ne veut s’exprimer publiquement et risquer ainsi d’être interprété comme une caution du régime Horthy, puis des Croix fléchées, et enfin du régime totalitaire communiste qui se met en place après la guerre.
« Se taire, se taire encore. Tirer des leçons de saint Benoît. Se réfugier dans un silence de plus en plus profond, de plus en plus sourd, de plus en plus obstiné » (Sándor Márai, 1944).
Si cette période reste relativement fructueuse – Márai termine alors La Mouette et « La Sœur », entame et achève « Libération », travaille à la suite de son roman « Les révoltés » – ce sont des écrits que leur auteur ne conçoit que « pour le tiroir ». Le Journal se fait alors l’illustration du processus créatif de l’écrivain, de son rapport difficile à l’écriture (« chaque ligne que j’écris (…) éveille en moi une angoisse et une inquiétude indicible », écrit-il en 1943), du soulagement qu’il ressent parfois à la lecture de ses textes plus anciens, et surtout des réflexions que lui inspirent les lectures qui l’accompagnent malgré la perte, dans les bombardements de Budapest au cours de l’hiver 1944-45, d’une grande partie de sa bibliothèque. Au-delà de la fabrique de l’écrivain, ce Journal est aussi un document sur la texture de la guerre : à Budapest, Márai assiste, en spectateur impuissant, au départ des convois des Juifs déportés ; plus tard, réfugié dans un village au nord de Budapest, il ne peut que noter « la paix profonde et réparatrice » qui règne sur les bords du Danube alors que les Russes font leur entrée dans la banlieue de Budapest et qu’en plein centre de la ville l’effondrement du pont Marguerite précipite dans le fleuve des tramways bondés de passagers.
« Márai le mentionne de manière très discrète dans le Journal, mais il a aidé beaucoup de Juifs pendant la guerre », dit Catherine Fay, à commencer par son beau-père qu’il échoue cependant à faire sortir du ghetto de Kassa (aujourd’hui la ville slovaque de Košice). Ce sont d’abord les sentiments que lui inspire la société hongroise qui le poussent à envisager, début 1945, de quitter le pays pour commencer une nouvelle vie à l’étranger. « Márai décrit très bien l’amertume, le dégoût qu’il ressent pour la mentalité hongroise, avec des passages qui mettent en lumière le comportement de masses et de dirigeants qui n’ont pas beaucoup résisté face à la nazification croissante du pays », ajoute sa traductrice.
« J’ai vu avec quel empressement elle a renié ses valeurs et commencé à persécuter tout ce que, au fond de son cœur, elle avait toujours haï : d’abord les Juifs, ensuite tous ceux qui incarnaient le talent et la qualité, qui auraient donc pu gêner ses affaires « chrétiennes et nationales ». Il est moralement impossible de passer là-dessus, il est impossible de s’y faire, de construire des projets en l’ignorant, impossible de reprendre là où on s’était arrêté… » (Sándor Márai, 1945).
Une brève fenêtre de normalité après la fin de la guerre lui permet de publier en Hongrie en 1946 des premiers extraits, retravaillés, de son Journal des années 1943-1944. Mais la question du départ se fait de plus en plus lancinante : même s’il peut à nouveau publier, si des responsabilités littéraires lui sont proposées par le nouveau régime, « Márai ne veut pas écrire pour servir de caution, d’otage, mais il ne peut pas non plus envisager de rester en Hongrie et de cesser d’écrire », explique sa traductrice. Ce premier volume se termine donc le 31 décembre 1948 alors que Márai, qui a quitté – définitivement, comme il s’avèrera plus tard – la Hongrie, vient de s’installer à Naples avec sa femme et leur fils adoptif János.
Si le Journal se fait le révélateur d’une facette plus intime de la personnalité de Márai, portée notamment par ses réflexions sur le poids de l’âge et de la maladie et sur son rapport difficile à l’alcool, l’écrivain reste très discret sur sa vie privée. On y lit l’évolution de sa relation avec « l’enfant » János, orphelin que la femme de Márai recueille alors qu’il est âgé de quatre ans : l’écrivain l’observe, l’emmène à la piscine, l’inscrit à l’école et, petit à petit, se laisse conquérir par lui. Plus rares sont les apparitions de « L. », initiale désignant sa femme Ilona Matzner, dite Lola, épousée vingt ans auparavant et que ses origines juives obligent à se cacher durant la guerre.
A la question de savoir ce qui, des romans, des mémoires et du Journal, permettrait le mieux aux lecteurs d’accéder à l’homme derrière l’écrivain, Catherine Fay répond presque sans hésiter que ce serait, justement, le journal tenu par Lola. Celle-ci, dit-elle, gagne en importance au cours des années d’exil et c’est surtout dans le dernier tome du journal (celui qui, dans le découpage hongrois, recouvre les années 1982-1989) que Márai évoque, après le décès de sa femme en 1986, celle qui aura toujours été présente à ses côtés. Pour Fay, il ne fait aucun doute que le journal de Lola, conservé parmi les archives de Sándor Márai au Musée Petőfi de Littérature de Budapest, donnerait une vision encore plus proche d’une personnalité que ses écrits et les photographies conservées font transparaitre comme plutôt raide.
« Ma mère a vécu le siège, à Budapest, et ce livre m’a touché parce que c’étaient les histoires que me racontait ma mère. J’ai eu envie de le traduire » – Catherine Fay.
Les lecteurs français devront encore patienter avant d’accéder à la suite du Journal de Márai, pour laquelle Albin Michel prévoit d’ici 2022 ou 2023 la publication de deux autres volumes, l’un recouvrant les années d’exil en Italie et à New York (1948-1967) et l’autre celui du retour en Italie à Salerne puis de l’installation définitive à San Diego jusqu’à la mort de l’écrivain en 1989. Si l’on prend en compte le fait que l’édition complète hongroise comprend 18 volumes, la préparation d’une publication accessible au public français représente un défi important de sélection et d’annotation des entrées du Journal. Cette tâche, Catherine Fay s’y est attelée avec András Kányádi, universitaire établi à Paris[1]Maître de conférences à l’Inalco, András Kányádi a dirigé entre autres l’ouvrage collectif La fortune littéraire de Sándor Márai, paru aux Editions des Syrtes en 2012. : ensemble, ils sélectionnent les passages à retenir, selon des critères littéraires ainsi qu’historiques.
L’intérêt et la beauté de la phrase et du style sont un critère de sélection évident, dit Fay, mais l’intérêt historique de la vision de Márai, l’aspect personnel et familial, le travail de l’écriture en progrès ont aussi joué dans la sélection. Sans en faire une priorité, Fay et Kányádi ont aussi gardé ce qui a trait à la France (Márai lit notamment à cette époque les journaux d’André Gide et de Julien Green), tout en sachant que ce critère sera amené à évoluer au cours des volumes suivants portant sur les années d’exil italien et américain de l’écrivain. Enfin, ils ont gardé « beaucoup de choses courtes, des aphorismes, des passages ironiques ou drôles qui montrent un autre aspect de l’écrivain », dit Fay, ajoutant que « ce choix à deux a été positif, car il apporte un degré d’objectivité. Il était aussi rassurant de voir que nous avons gardé pratiquement les mêmes choses ». Un appareil de notes préparé par András Kányádi complète également le contexte historique d’une période dont le déroulement en Hongrie reste peu connu des Français.
« Il ne suffit pas d’écrire un Journal. Il faut le lire également, tout aussi régulièrement qu’on l’écrit ; c’est là qu’il prend sens. »
Avec la publication de ce Journal, le travail de Catherine Fay s’inscrit ainsi dans la prolongation non seulement d’une longue implication des éditions Albin Michel avec Márai (qui a publié depuis 1992 une vingtaine d’œuvres en traduction), mais aussi de la traductrice elle-même avec l’œuvre de l’écrivain. C’est en effet avec Márai que Fay est venue à la traduction, au milieu des années 2000 : « j’ai commencé la traduction assez tard dans ma vie, en 2006. J’avais lu le livre « Libération » (Szabadulás), en 2000, que Márai avait écrit à chaud en 1945 pendant et après la libération de Budapest. Ma mère a vécu le siège, à Budapest, et ce livre m’a touché parce que c’étaient les histoires que me racontait ma mère. J’ai eu envie de le traduire », dit-elle. Albin Michel publie en 2007 ce roman inspiré des événements auxquels Márai assiste durant le siège de Budapest et dont il évoque la genèse dans son Journal : une forme, pour sa traductrice, de clôture du cercle maraïen.
Notes
| ↑1 | Maître de conférences à l’Inalco, András Kányádi a dirigé entre autres l’ouvrage collectif La fortune littéraire de Sándor Márai, paru aux Editions des Syrtes en 2012. |
|---|
