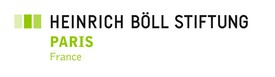Entretien avec Maciek Hamela, réalisateur du film « Pierre Feuille Pistolet », un documentaire poignant qui documente l’exode des populations civiles ukrainiennes, au cinéma en France le 8 novembre.
« Peu importe où l’on va. On veut juste mettre les enfants en sécurité ». C’est la phrase clé de ce film extrêmement poignant, un huis-clos dans l’habitacle d’un vieux monospace qui sert de refuge précaire à des gens qui viennent de tout perdre et doivent tout quitter après l’invasion russe. Une petite fille dans les bras de son père ne parle plus depuis que la guerre a éclaté, une femme a une balle dans le corps, des paysans s’inquiètent de ce que vont devenir leurs vaches, une famille pleure les animaux de compagnie laissés derrière elle, une jeune femme enceinte, mère-porteuse, raconte ses projets d’avenir, ouvrir un café, une autre dit ironiquement qu’avec l’exil elle va enfin voir l’Europe et Paris.
Les rares fois où la caméra se tourne vers l’extérieur, c’est un vertige de destruction, des voitures de civils en fuite détruites et abandonnées le long de la route, des tanks calcinés, des check-points militaires, la route qui s’achève sur un pont effondré ou sur un champ de mines semé à la hâte… Et au volant, il y a Maciek Hamela, l’artisan des sauvetages, et qui recueille les témoignages de ces rescapés, dignement exposés dans ce film au cinéma en France à partir du 8 novembre.

Le Courrier d’Europe centrale : Votre film a déjà reçu plusieurs prix dans des festivals. Quelle est la réception par le public ?
Maciek Hamela : Assez forte. J’étais à Bayeux il y a deux jours, la salle était pleine, les gens posaient beaucoup de questions, les discussions se poursuivaient longtemps après le film. Les gens veulent savoir comment s’engager. Des communautés ukrainiennes en exil sont présentes à presque toutes les projections. Le film a remporté le grand prix du documentaire à Zurich. L’ambassadrice d’Ukraine est montée sur scène pour raconter son histoire personnelle, comment elle a organisé l’évacuation de ses enfants de Kharkiv. Aujourd’hui encore, elle ne sait pas qui les a conduits. A La Rochelle, une famille ukrainienne m’a raconté comment les associations locales ont pris en charge une troupe de danse. Ce sont des émotions très fortes, il y a beaucoup de moments touchants. Je pense qu’avec ce film, les gens voient vraiment un visage de la guerre qu’ils n’avaient pas vu avant, parce que ce n’est pas ce que l’on montre à la télé.
Votre film sort à un moment où l’on commence à parler de la « fatigue de la guerre », à un moment où le soutien de certains pays semble flancher, y compris le vôtre, la Pologne. Qu’en pensez-vous ?
C’est compliqué. D’un côté, il y a ce que les gens ressentent et les messages politiques du moment, liés aux élections en Pologne. Je suis certain que cela a un impact sur le ressenti, surtout dans l’Est de la Pologne, où il y a beaucoup d’Ukrainiens. La fatigue est là, évidemment, et dès qu’il y a de la frustration, on a tendance à s’en prendre aux minorités, et les Ukrainiens sont devenus la plus grosse minorité nationale en Pologne.
Mais selon moi cela reste minoritaire. On se connaît assez bien avec les Ukrainiens, depuis des années, ce n’est pas comme s’ils venaient pour la première fois en Pologne. J’ai été frappé par les images d’une manifestation organisée par l’extrême droite, il y a deux ou trois mois, contre « l’ukrainisation » de la Pologne, où il n’y avait personne, la place était vide. A l’inverse, dans le réseau de bénévoles il y a encore énormément de gens mobilisés pour l’aide humanitaire à l’Ukraine.
Je leur expliquais en cours de route ce que l’on faisait et ce n’est qu’à la fin du voyage que je leur demandais de signer l’autorisation d’utiliser leur image, pour ne surtout pas les piéger. Une seule personne a refusé de signer.
Comment est née l’idée de faire ce film ? Était-ce d’abord projet humanitaire qui est devenu un film ou l’idée de départ était vraiment c’est de trouver le dispositif idéal pour documenter la fuite des populations civiles ?
Au départ, il n’était absolument pas question de faire un film. Le 24 février 2022, j’ai mis tous mes projets en pause et refusé toutes nouvelles sollicitations, pour m’engager comme chauffeur bénévole. L’idée est venue plus tard, avec la fatigue de faire les trajets tout seul. J’avais besoin d’une seconde personne pour me relayer derrière le volant. C’est un ami, qui est chef-opérateur qui m’a accompagné. On s’est dit, « emmenons une caméra, peut être que l’on arrivera à documenter les choses en même temps », mais sans certitude aucune que cela ne fonctionne. On n’était pas sûrs du tout de réussir à capter ce qu’il se passe à l’intérieur de ce véhicule ni de pouvoir en faire un film. Beaucoup de questions se posaient, notamment celle de ne pas exploiter les gens.
Est-ce qu’il y a des passagers qui ont refusé la présence de la caméra ?
Personne n’a refusé la caméra, mais certains évidemment n’étaient pas très bavards ni ouverts. Je les avertissais de sa présence avant de monter à bord. Il faut savoir qu’en Ukraine cela ne choque personne, car la guerre est très médiatisée, ils ont l’habitude et cela leur semblait tout à fait normal. Je leur expliquais en cours de route ce que l’on faisait et ce n’est qu’à la fin du voyage que je leur demandais de signer l’autorisation d’utiliser leur image, pour ne surtout pas les piéger. Une seule personne a refusé de signer.
Combien de personnes avez-vous convoyé ?
Au total, environ quatre cents personnes. Mais en parallèle, ma tâche principale était d’organiser des évacuations, par exemple d’hôpitaux, en car.
Êtes-vous resté en contact avec certains des passagers ? Savez-vous ce qu’ils sont devenus ?
Oui absolument, je reste en contact avec un certain nombre d’entre eux. Certains sont passés par mon appartement à Varsovie, d’autres ont logé dans la maison de mon père. Une douzaine d’entre eux est venue assister à la première du documentaire à Varsovie. Larissa, qui vit en France, est venue à notre première à Cannes et depuis elle voyage avec les films sur des festivals en France. Et puis d’autres m’envoient des messages pour prendre des nouvelles.
La jeune femme congolaise qui raconte s’est fait tirer dessus délibérément par des soldats et que vous transportez blessée s’en est-elle tirée ?
Elle a dû passer par seize opérations, mais ils ont réussi à extraire la troisième balle qui restait dans son corps et sa jambe a pu être sauvée. Elle est venue de Berlin à Varsovie pour assister à la première et elle sera présente lors d’une projection à Berlin.
J’ai aussi été chauffeur pour une organisation américaine qui aidait les étudiants étrangers, d’origine africaine surtout, à quitter le pays. La plupart d’entre eux se trouvaient dans des zones déjà occupées et leur accès était difficile. Le plus dur, c’était pour les Roms. J’en ai vu énormément à la frontière polonaise, que personne ne voulait prendre en charge et qui restaient traîner dans les centres d’accueils.
Quelle est la scène du film la plus forte selon vous, et la personne qui vous a le plus touché ?
Difficile à dire… Certains avaient des témoignages très forts mais ne restaient à bord que quelques heures. Peut-être Evelina, la jeune mère-porteuse avec sa mère, qui est elle aussi mère-porteuse, avec qui on a voyagé trois jours. Son histoire me frappe car elle montre la fragilité économique dans laquelle vivaient ces gens. Et la guerre est venue tout leur prendre.
Et pourtant elle garde un espoir incroyable.
Exactement, elle arrive à rester optimiste et à garder espoir.
La scène où l’on vous voit déboucher sur un pont effondré est très impressionnante.
C’était assez quotidien comme expérience, surtout au début de la guerre quand on n’avait pas de bonnes infos sur les ponts praticables ou déjà détruits. On a souvent dû faire demi-tour, parfois sur deux cents kilomètres. Là, on a décidé de ne pas risquer de passer par le pont militaire, ça nous semblait trop dangereux. Parfois on réussissait à passer sur ces ponts provisoires construits par l’armée. Toutes les pannes qu’a connues le véhicule et ce genre d’imprévus étaient notre lot quotidien.
Pourquoi avoir fait le choix de ne donner aucune indication de temps et d’espace ?
Il est vrai que ceux qui connaissent l’Ukraine aimeraient savoir où et quand les choses se passent. Mais on a vite compris que l’on ne faisait pas un film seulement sur la guerre en Ukraine, racontant son déroulé et sa chronologie. L’important, c’est ce qu’il se passe dans l’habitacle du véhicule. C’est pour cela que j’ai décidé de ne pas mentionner les noms de lieux et les dates. Cela évite aux spectateurs de se poser des questions qui ne sont pas nécessaires. D’ailleurs, à la post-production on a désaturé l’environnement extérieur au véhicule, afin de ne pas troubler le spectateur avec les changements de saison, comme le passage de l’hiver au printemps.
Propos rapportés par Corentin Léotard, mi-octobre, par téléphone.
Article publié avec le soutien de Heinrich Böll Stiftung | Bureau Paris – France.