Dans Tchernobyl par la preuve, un livre nourri de témoignages touchants et d’archives inédites, l’historienne Kate Brown analyse les efforts des autorités soviétiques et occidentales pour minimiser les conséquences sanitaires de Tchernobyl. Le Courrier d’Europe centrale l’a rencontrée à l’occasion de la traduction de son ouvrage en français.
Article publié en coopération avec la Heinrich-Böll-Stiftung Paris, France.
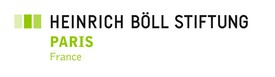
Kate Brown est une historienne de l’environnement et professeure au M.I.T. (Massachusetts Institute of Technology). Après Plutopia : Nuclear Families, Atomic Cities, and the Great Soviet and American Plutonium Disasters (“Plutopia : familles nucléaires, villes atomiques, et les désastres du plutonium soviétique et américain”, 2013, non traduit), un premier livre sur deux villes américaines et soviétiques créées pour produire du plutonium, nécessaire à la fabrication de bombes atomiques, la chercheuse américaine s’est intéressée à Tchernobyl.
Pendant une dizaine d’années, elle a décortiqué les archives soviétiques pour comprendre pourquoi le bilan officiel de l’accident était aussi bas : de 31 à 54 décès, selon les agences de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Dans son ouvrage Manual for Survival: A Chernobyl Guide to the Future (“Manuel de survie : un guide de Tchernobyl pour l’avenir”, Allen Lane, 2019), Kate Brown rend compte des efforts des autorités soviétiques et des agences internationales pour minimiser les conséquences sanitaires de Tchernobyl. S’appuyant sur des enquêtes de terrain en Ukraine et au Bélarus, elle détaille les stratégies de survie des habitants des provinces contaminées, mais aussi les efforts de quelques scientifiques et dirigeants locaux pour protéger la population.
A l’occasion de la publication en français de son ouvrage aux éditions Actes Sud en mars, Le Courrier l’interroge sur les conséquences d’un des pires accidents de l’histoire du nucléaire civil, 35 ans après.
Le Courrier d’Europe centrale : Le titre original de votre ouvrage est Manual for Survival: A Chernobyl Guide to the Future. Pourquoi présenter vos recherches comme un “manuel de survie” ?
Kate Brown : En travaillant dans les archives, ce qui me frappe, c’est de trouver de nombreux manuels, comme des modes d’emploi pour un nouveau chapitre de l’histoire de l’humanité. Il y a un guide pour les travailleurs de l’industrie de la viande, pour les fermiers, les boulangers, les médecins. Comment survivre dans un paysage post-nucléaire ? Comment nettoyer et décontaminer une viande ? Comment soigner des maladies liées aux radiations ? Il y a un mode d’emploi pour tout en fait !
Tchernobyl n’est pas la première catastrophe dans cette région marécageuse [de Polésie, situé dans le nord de l’Ukraine et le sud du Bélarus, ndlr]. Certaines des plus importantes batailles de la Première Guerre mondiale se sont jouées aux abords du marais, puis la révolution russe, la guerre civile, la famine et les déportations dans les années 1930, la Seconde Guerre mondiale, l’Holocauste… Les ingénieurs soviétiques ont vu ce record de destructions dans cette province éloignée et ont décidé de “réparer” l’endroit, de le rendre plus prospère, en construisant une centrale nucléaire dernier cri. Et pourtant qu’est-ce qui se produit ? Encore un autre désastre.
J’ai donc pensé que si quelqu’un savait comment survivre, c’étaient bien ces gens, qui ont vécu si longtemps dans la région et ont trouvé des moyens de survivre aux désastres. C’est pour cela que j’ai un chapitre dédié à Halia, une vieille dame qui avait 99 ans lors de notre dernière rencontre. J’étais fascinée par sa capacité de résistance. Je voulais raconter sa manière de vivre dans la région. Autour d’elle, tellement de gens sont partis, les uns après les autres, une calamité après l’autre, mais elle a réussi à rester en vie.

On imagine souvent la radiation comme des rayons invisibles dans l’air, mais elle peut aussi se fixer sur des objets : la poussière, l’eau, mais aussi les meubles, la nourriture, la laine… Comment la radioactivité se répand-elle dans la République Socialiste Soviétique (R.S.S.) d’Ukraine et même dans toute l’Union dans les années qui suivent l’accident ?
En parcourant les archives du ministère de l’Agriculture [ukrainien], je me rends compte que les radiations suivent et s’appuient sur les vecteurs humains de communications. Et que font les humains ? Ils vont dans la forêt et récoltent des champignons, des baies, du bois et les ramènent chez eux. Ils vont aux champs et ramassent leurs récoltes, les rapportent au village, avec les roues des charrettes et des tracteurs couvertes de boue et de poussières radioactives. Après l’accident, tout est radioactif : la viande, le miel, les baies, les récoltes, même le thé. Les locaux vendent et exportent leurs produits qui s’éparpillent dans le pays. Les populations respirent la poussière, mangent les aliments contaminés et les radiations se retrouvent dans leurs corps.
En fonction des isotopes radioactifs, les radiations se logent dans la chair du corps, dans la moelle osseuse, dans les poumons, la glande thyroïde. Ces isotopes imitent les minéraux dont le corps a besoin pour survivre, et se fixent là où ils sont nécessaires. Et puis, les organes commencent à moins bien fonctionner et les personnes développent des maladies chroniques qui rendent la vie plus compliquée : maux de ventre, troubles respiratoires ou cardiaques, problèmes de peau, cataractes… Voilà donc le genre de symptômes subaigus qui se manifestent dans la population, surtout au cours des cinq premières années [après l’accident, ndlr]. Et puis cette radioactivité s’accumule dans les corps. Les cellules peuvent se réparer elles-mêmes, mais pas toutes, et celles qui ne se réparent pas reproduisent ces dommages, qui se transforment en tumeur ou cancer. Le processus peut prendre cinq, dix, vingt ans.
C’est le problème de l’exposition aux faibles doses. Des chercheurs locaux ont trouvé que le taux de malformations et de maladies chez les enfants était beaucoup plus élevé dans le nord de l’Ukraine par rapport au reste du pays, dans des régions parfois à des centaines de kilomètres de la centrale.
C’est intéressant d’en parler en temps de pandémie, car aujourd’hui, vous êtes exposés et trois jours plus tard, vous avez des symptômes. Avec le virus, vous pouvez être testés rapidement et établir des connexions. Le problème avec les radiations, c’est que les conséquences sont éloignées du lieu et du moment de l’exposition. Donc, vous pouvez être un enfant de liquidateur [les soldats ou civils dépêchés sur place après l’accident pour sécuriser et décontaminer la centrale et ses alentours, ndlr] ou un habitant de Polésie mangeant des aliments contaminés, mais les conséquences des radiations prennent des années à se manifester dans votre corps. Il est donc beaucoup plus difficile de déterminer la causalité dans ce cas. Il n’y a probablement pas qu’un coupable, car nous avons des couches de contaminants toxiques qui se superposent. Dans le nord de l’Ukraine, à cause de Tchernobyl, il y en a d’autant plus.
Dans ce genre de cas, le travail des épidémiologistes est très difficile. Mais ce qui ressort des archives soviétiques dès les cinq premières années après l’accident, c’est ce volume écrasant de preuves de l’impact énorme de Tchernobyl sur la santé des gens qui vivent dans la région et se nourrissent localement. La question est de savoir quelle est la cause exacte de ces problèmes de santé. Les agences onusiennes disent que c’est dû au stress. Ces personnes sont anxieuses de vivre dans une zone contaminée et cela cause des problèmes de santé. Mais ces gens ne savent pas qu’ils vivent dans des zones contaminées. Ils ont peut-être des soupçons, mais aucune carte n’est publiée avant 1989. Les agences de l’ONU se basent sur une étude qui a montré une corrélation entre l’anxiété et ces problèmes de santé rapportés. Mais elle n’est basée que sur de la pure spéculation. J’appelle ça de la mauvaise science: “nous voyons beaucoup d’anxiété, nous voyons beaucoup de problèmes de santé, alors ils doivent être liés”. C’est aussi grave que de dire “nous voyons beaucoup de radiations, nous voyons beaucoup de problèmes de santé, cela doit être lié”. Quoi qu’il en soit, le plus gros problème est qu’il n’y a eu aucun effort réel pour évaluer les conséquences sanitaires de Tchernobyl. C’est l’argument de mon ouvrage : nous ne pouvons pas obtenir des réponses aux questions que nous ne posons pas.
Chronologie de l’accident
- 26 avril 1986 À 1h23 du matin, à environ 150 kilomètres au nord de Kiev, le réacteur n°4 de la centrale de Tchernobyl explose à la suite d’erreurs lors d’un test de sécurité. L’incendie du combustible nucléaire va durer 10 jours.
- 27 avril 1986 30 heures après l’accident, l’évacuation commence. Au total, 120.000 personnes habitant dans un rayon de 30 km seront déplacées en deux semaines.
- 28 avril 1986 La Suède enregistre une hausse de la radioactivité sur son territoire et lance l’alerte.
- Mai – novembre 1986 Construction du premier sarcophage en béton au-dessus du réacteur. Un autre en acier sera mis en place en 2016.
- 15 décembre 2000 Fermeture définitive de la centrale.
Cinq ans après les bombardements atomiques d’Hiroshima et Nagasaki, une étude sur 200.000 sujets pour déterminer les effets des radiations sur la santé à long terme a démarré. Une étude épidémiologique de grande ampleur similaire est-elle conduite après Tchernobyl ?
Dès le début, des scientifiques internationaux et de l’Union soviétique déclarent qu’il s’agit d’un accident très malheureux, mais que c’est aussi une rare opportunité d’étudier les populations exposées à des doses chroniques de radiations. Ils pensent qu’il devrait y avoir une étude à long terme, à l’image de celle sur les survivants japonais.
Cependant, cette étude n’est jamais financée et je soutiens dans mon livre que c’est pour des raisons tout à fait politiques. En 1989 et 1990, l’AIEA [Agence internationale de l’énergie atomique, agence de l’ONU chargée de la promotion de l’usage pacifique de l’énergie nucléaire, ndlr] est chargée de faire une évaluation indépendante, demandée par les dirigeants de Moscou qui tentent de fermer le chapitre sur la catastrophe de Tchernobyl. Ils font cette étude, et en même temps une autre branche de l’ONU, l’Assemblée générale prépare une collecte auprès des donateurs internationaux avec pour but de récupérer un milliard de dollars [au cours actuel], pour financer une étude à long terme sur les conséquences sanitaires de Tchernobyl et pour déplacer environ 200.000 personnes des territoires très contaminés.

Mais l’AIEA précipite son évaluation et la publie avant que ses partenaires russes, biélorusses et ukrainiens ne la lisent, et avant même qu’elle ne soit traduite en langues slaves, le but étant de déclarer qu’il n’y avait plus de problèmes à Tchernobyl. Cela permet à l’agence de dire qu’il n’y a plus besoin d’autres études. Ces déclarations impactent grandement la campagne d’engagement de l’Assemblée générale. Au lieu de lever un milliard de dollars, ils ne lèvent que quelques millions.
Nous n’avons donc pas d’étude de long terme et à grande échelle, mais nous avons des études plus petites que je suis vraiment étonnée de trouver dans les archives au Belarus. A l’époque, c’est le pays le plus durement touché par les radiations. L’Académie des sciences de la République socialiste soviétique de Biélorussie agit séparément du Ministère de la Santé qui minimise les effets de l’accident. Dans les mois qui suivent l’accident, l’académie commence à mettre en place des études sur les enfants des zones contaminées, avec des groupes témoins. Ils observent des résultats alarmants, avec des enfants souffrant d’anémie pernicieuse, de cancers de la thyroïde. Les chiffres explosent de 1986 à 1990. Les études qu’ils font sur le terrain sont solides et préoccupantes pour les enfants. Les scientifiques savent ainsi dès les premières années que les enfants et les femmes enceintes seraient les plus durement touchés.
Dans votre livre, vous expliquez que les médecins soviétiques et les médecins occidentaux pratiquent la médecine des radiations différemment et que cela a un impact sur leur estimation des dégâts.
Quand Tchernobyl se produit, les Soviétiques ont déjà eu beaucoup d’accidents nucléaires, mais tous sont gardés secrets. La conséquence, c’est que la médecine nucléaire est dans ce qu’ils appellent “une boîte postale”, des institutions militaires fermées où il faut avoir une habilitation de sécurité pour lire toute documentation qui sort de ces institutions. Les médecins soviétiques ne sont pas autorisés pour des raisons de sécurité à avoir accès aux dossiers de surveillance des rayonnements, alors ce que font les médecins, c’est qu’ils prennent les patients très malades, sans savoir à quoi ce patient avait été exposé, ni combien de temps, et ils commencent à utiliser le corps comme un compteur Geiger [instrument de mesure servant à mesurer un grand nombre de rayonnements ionisants, ndlr]. Ils étudient les changements dans le corps, les mutations chromosomiques. Ils comptent les globules blancs. Ils regardent l’émail des dents pour voir s’il y a des traces de radiations. Le corps est donc devenu leur principale archive pour déterminer la dose reçue.
A l’époque, les médecins occidentaux ont une approche différente qui consiste à évaluer les radiations dans l’environnement ambiant et à en déduire la dose reçue. Ils utilisent l’étude sur les survivants d’Hiroshima et de Nagasaki pour déterminer les conséquences sur la santé en fonction des niveaux de rayonnements. Les scientifiques occidentaux extrapolent d’Hiroshima à Tchernobyl. Mais le problème avec cela, c’est que Hiroshima est considérée comme une seule grande radiographie. La dose comptée provient d’une exposition qui a duré moins d’une milliseconde de rayon gamma [il existe trois types de rayons : gamma, alpha et bêta, ndlr] traversant un corps et quittant le corps, quand la bombe explose. Dans leur étude, les scientifiques ne comptent pas les retombées radioactives sur Hiroshima et Nagasaki par la suite. Ils le font pour des raisons politiques, les Américains craignent beaucoup que les armes nucléaires soient classées comme armes biologiques et chimiques et armes de guerre illégale, car après l’explosion, les effets persistent et causent des dommages à la santé humaine comme dans une guerre biologique et chimique.

Alors ils n’arrêtent pas de dire qu’il n’y a pas de retombées radioactives. Que seule compte l’explosion. L’exposition [des populations] à Tchernobyl ne se résume pas à une explosion. Les expositions gamma sont importantes, mais pas aussi importantes que l’ingestion de débris radioactifs dans la nourriture qui restent dans le corps. Les corps sont de très bons protecteurs biologiques contre les particules alpha et bêta à l’extérieur, mais une fois qu’ils sont à l’intérieur de votre corps, il n’y a plus rien pour vous protéger.
C’est donc l’un des problèmes majeurs. Et l’une des différences majeures est que les Soviétiques sont très concentrés sur les corps et que les Occidentaux ont une sorte de stratégie de gestion des risques qu’ils utilisent pour estimer les doses, et donc les dommages.
Ils le font pour des raisons politiques, les Américains craignent beaucoup que les armes nucléaires soient classées comme armes biologiques et chimiques et armes de guerre illégale, car après l’explosion, les effets persistent et causent des dommages à la santé humaine comme dans une guerre biologique et chimique.
Ces deux façons de procéder radicalement différentes conduisent les Occidentaux à constamment minimiser les conclusions des médecins soviétiques puis ukrainiens, biélorusses et russes.
Les consultants de l’ONU et d’autres d’organisations occidentales à but non lucratif se rendent sur place les années suivant la catastrophe, et ont tendance à discréditer les conclusions des médecins soviétiques. C’est déroutant parce que ces scientifiques internationaux sont parachutés dans la région pendant environ deux semaines, ils récupèrent quelques informations et repartent, là où les médecins soviétiques sont sur le terrain. Ils sont sur le terrain depuis 1986. Depuis au moins quatre ans, ils étudient près d’un million de corps. Mais les médecins occidentaux ont cette hypothèse très forte issue de la guerre froide, selon laquelle tout ce que les Soviétiques faisaient est juste mauvais : leur économie, leur politique, leur technologie… c’est d’ailleurs pourquoi Tchernobyl est arrivé, selon eux. Et donc, leur science et leur médecine sont forcément mauvaises aussi. C’est facile de les discréditer sur cette base.
Dans votre livre, vous vous basez beaucoup sur vos rencontres avec des témoins de l’Histoire. Est-ce qu’il y a une personne, une rencontre qui vous a particulièrement marquée ?
Oui, il y a cette femme : Natalia Lozytska. A l’époque de Tchernobyl, elle est physicienne et enseigne aux étudiants de l’université de Kiev. Son mari est coordinateur chargé de la défense civile à l’université [chaque institution en a un en cas d’attaque nucléaire, ndlr]. Il a donc un compteur Geiger, un gros à l’ancienne, de la taille d’un grille-pain. Après l’accident, ils entendent les rapports rassurants des autorités. Quelques jours après, Natalia se rend donc au défilé du 1er mai sans crainte avec ses enfants. Mais quand elle revient, ses enfants ont un étrange coup de soleil violet sur le visage et ne se sentent pas bien.
Par la suite, Natalia remarque que sa fille s’évanouit de plus en plus souvent, le matin au pied du lit. Elle a des saignements de nez étranges. Suspicieuse, elle sort donc son compteur Geiger et commence à prendre des mesures dans la cour de l’université. Et elle constate une sorte de forte émanation de radioactivité, et finit, avec son mari, par trouver des petites taches au milieu de la poussière : des minuscules morceaux qui émanent puissamment. Et donc elle scotche un morceau sur un bout de papier – rien de high-tech – et le mesure dans les jours suivants. En mesurant, le taux de désintégration, elle détermine de quels isotopes il s’agit, du plutonium [un isotope très radioactif, utilisé dans la fabrication des bombes nucléaires, ndlr].
En découvrant quels isotopes se trouvaient dans l’atmosphère autour de Kiev, elle commence à comprendre ce qui se passe à 120 kilomètres de là, sur le site de Tchernobyl où il lui est interdit de se rendre. Elle écrit à ses dirigeants : “vous ne le savez peut-être pas, mais ce n’était pas une explosion de vapeur ou une exposition chimique, mais c’était une explosion nucléaire !”. Elle écrit une trentaine de lettres, sans réponses. Dans ses lettres que j’ai retrouvées, il y a son nom, son adresse et son numéro de téléphone, alors j’appelle le numéro de téléphone. Et elle répond ! Elle habite toujours dans le même appartement. Et elle est étonnée : « personne n’a jamais répondu à mes lettres. Vous êtes la première personne en 30 ans ». Et plus tard, en 1988, elle forme une sorte de groupe écologiste, très surveillé par le KGB, qui va de village en village pour alerter les habitants. Elle lance sa propre campagne pour informer les gens et leur répondre, ce que les médecins et les fonctionnaires officiels soviétiques ne font jamais.
En mai 1988, elle se déguise pour entrer dans une conférence internationale sur les conséquences médicales de la catastrophe, avec des hauts-fonctionnaires, des scientifiques étrangers. Depuis le podium, ils clament tous que tout va bien. Elle s’habille comme une femme de ménage, avec un seau et une serpillière, et se glisse directement dans la conférence à huis clos pour faire parvenir ses lettres à des scientifiques étrangers. Elle pense qu’ils vont ensuite les rapporter en Occident, comme à travers des réseaux dissidents, et que la vérité éclatera. Mais quatre gars du KGB se précipitent vers elle, l’attrapent par les coudes, la soulèvent et la déposent dans la ruelle du fond. Natalia fait partie de ces héros du quotidien, de gens qui savent comment survivre et comment aider les autres à survivre à ce genre d’accident, alors que les dirigeants et les officiels abdiquent leurs responsabilités.

Il semble d’ailleurs que les autorités soviétiques des R.S.S. d’Ukraine et de Biélorussie réagissent différemment aux ordres de Moscou. Les Ukrainiens font beaucoup plus de zèle.
L’idée des autorités est que l’accident s’est produit en Ukraine et qu’il s’agit d’un problème ukrainien. Ainsi, les Biélorusses, même si Tchernobyl n’est qu’à six kilomètres de la frontière, ne sont jamais vraiment informés officiellement qu’il y a eu un accident. Le chef du parti communiste biélorusse doit appeler le chef de la section locale du parti ukrainien et lui demander pourquoi les compteurs Geiger s’affolent à Minsk. Il y a au même moment une réunion en cours à Moscou à laquelle les Biélorusses ne sont pas conviés.
La R.S.S. d’Ukraine est une république assez puissante, la deuxième république la plus puissante après la Russie. Elle a de grands instituts de recherche, y compris des instituts spécialisés sur le nucléaire. Celle de Biélorussie a juste un tout petit institut, dirigé par un physicien très dynamique. Il est très bon en coulisse pour mobiliser les scientifiques biélorusses de l’Académie des sciences, mais le ministère de la Santé biélorusse a reçu l’ordre de seulement faire des inspections médicales. Ils conduisent des recherches, mais de manière superficielle et expéditive.
Vous pouvez voir dans les documents des archives que personne ne fait vraiment de gros efforts. La population d’un village diminue de moitié et ils disent : « Nous ne voyons aucun changement dans la population ». En Biélorussie, ce sont simplement des fidèles membres du parti communiste qui obéissent sans poser de questions. Là où l’Ukraine se bat continuellement avec Moscou pour prendre davantage de mesures pour protéger notre population. Certains dirigeants ukrainiens, comme le ministre de la Santé de l’époque, Anatolii Romanenko, sont vilipendés dans la presse par la suite car ils minimisent les conséquences de Tchernobyl. Mais en coulisse, ils se battent pour protéger la population ukrainienne, contre l’avis de Moscou.
A l’occasion de l’anniversaire des 35 ans de l’accident, le Service de sécurité d’Ukraine (SBU) a publié de nombreux documents incriminant Moscou. En général, quel est l’enjeu politique de la mémoire de Tchernobyl pour les Ukrainiens, qui semblent les plus actifs dans la publication des archives ?
J’ai travaillé dans ces archives dans le cadre de ce projet de livre, et je n’ai pas vu exactement ce qu’ils ont publié cette année. Mais, ils publient ces documents chaque année depuis environ 15 ans. Par exemple, ils mentionnent ici que le KGB a rapporté à Mikhaïl Gorbatchev [à la tête de l’URSS de 1985 à 1990, ndlr] les dysfonctionnements de cette centrale avant même l’accident. Avant celui de 1986, il y a eu 104 accidents à Tchernobyl et c’est remarquable sachant qu’elle ne fonctionnait depuis à peine six ans.
L’enjeu est politique et géopolitique. En 1990 et 1991, les Ukrainiens plaident en faveur de leur indépendance en faisant valoir qu’ils ont été victimes des communistes, des communistes à Moscou, et en général des Russes. D’abord, il a eu la grande famine en Ukraine, l’Holodomor, puis maintenant Tchernobyl. Selon eux, pour voir la préservation de la nation ukrainienne, ils doivent être un État souverain et indépendant. Ils utilisent vraiment leur victimisation comme une justification pour l’accès à la souveraineté, à l’indépendance, et Tchernobyl est étroitement liée à cela.
Selon eux, pour voir la préservation de la nation ukrainienne, ils doivent être un État souverain et indépendant. Ils utilisent vraiment leur victimisation comme une justification pour l’accès à la souveraineté, à l’indépendance, et Tchernobyl est étroitement liée à cela.
L’une des premières choses qu’ils font [après l’indépendance], c’est de créer ce très beau musée de Tchernobyl à Kiev. La ville de Tchernobyl était une ville juive polonaise, mais ce musée, ils enveloppent l’accident dans une iconographie de l’église chrétienne ukrainienne. Il est plein de ce folklore ukrainien, des rouchniki [un tissu rituel brodé, utilisé lors des services religieux, ndlr] sont enroulés autour de symboles nucléaires pour dire à quel point cet accident a endommagé la nation paysanne ukrainienne. Le musée met en valeur cette culture perdue des habitants de la Polésie, les plus touchés par l’accident, dans le nord de l’Ukraine. Vous ne voyez pas ce genre de chose en Biélorussie, ils ne le lient pas à la nation biélorusse de la même manière.
Dans votre livre, vous soutenez que Tchernobyl est “une grande accélération”, qu’entendez-vous par là ?
Il y a une réelle tendance à encadrer les évènements dans le temps et dans l’espace, et c’est exactement ainsi que les responsables de Moscou gèrent la catastrophe à l’époque. Ils dessinent un cercle autour de la centrale, ils le dépeuplent. Dans leurs discours, ils assurent que les radiations sont confinées “en toute sécurité” à cette zone, puis ils laissent passer un peu de temps et annoncent qu’ils sont prêts à passer à autre chose, que l’accident est terminé et qu’ils ont nettoyé autant que c’était possible. Ils essaient de faire cela en 1989, mais les populations locales protestent. Et puis l’ONU est venue et a aussi annoncé qu’elle ne voyait pas de problème majeur et qu’on pouvait tourner la page Tchernobyl. Cette approche, c’est voir Tchernobyl comme un simple accident, comme un événement distinct avec un début, un milieu et une fin.
Mais ce que je trouve quand je travaille dans les archives, c’est que ces marais de la rivière Prypiat étaient contaminés avant même la construction de Tchernobyl. Il y a une grande étude sur quatre ans, faite dans les années 1960 qui montre cela. D’où vient cette contamination ? Les documents soviétiques censurés disent que cela provient des retombées radioactives mondiales, des essais d’armes nucléaires, notamment américains, que le marais éponge. Il y a des signes que les Soviétiques eux-mêmes avaient un champ de tir de l’armée de l’air à cet endroit, et qu’ils testaient des armes nucléaires que les soldats étaient censés se lancer sur-le-champ de bataille. Nous voyons donc que cette zone de Tchernobyl était contaminée avant Tchernobyl.
Tchernobyl n’est pas une fin. De l’explosion de la première bombe nucléaire au Nouveau-Mexique jusqu’à très récemment les tests en Corée du Nord, c’est un continuum d’événements radioactifs.
En 2017, quand je fais des recherches dans la Forêt rouge [nom donné à la végétation forestière dans une zone de dix kilomètres autour de la centrale nucléaire de Tchernobyl, qui a pris une couleur rouge après l’accident, ndlr], je m’attends à 50 millisieverts par heure, mais mon compteur affiche plutôt 994 millisieverts[1]La limite légale d’exposition à la radioactivité en France est de un millisievert (mSv) par an, 20 mSv chez les travailleurs du nucléaire.. Quand je demande au biologiste que je suivais ce qu’il se passe, il me répond qu’un incendie est en cours. Le feu a remis en suspension les radiations de Tchernobyl, enfouies dans la litière de feuilles et dans le bois. L’incendie les a transformées en fumée et en cendre et elles voyagent loin. Vous voyez donc que le rayonnement de Tchernobyl continue longtemps après l’événement.
Mais Tchernobyl doit être vu comme un événement avec un début, un milieu et une fin, car il sert de justification pour les autres accidents nucléaires. Dans les années 1990, il y a des tas de procès de personnes poursuivant leurs gouvernements, en Grande-Bretagne, en France, en Russie, aux États-Unis, parce qu’elles ont été exposées à des radiations. Elles ont été exposées à une contamination radioactive résultant des essais et de la production d’armes nucléaires, et l’apprennent à mesure que les archives de la guerre froide sont déclassifiées. Et donc, pour éviter les poursuites, les autorités occidentales disent “regardez Tchernobyl, le pire accident nucléaire au monde et seulement 31 personnes sont mortes”. Par conséquent, quand vous vivez à proximité d’une usine de plutonium ou dans le sens du vent d’un site d’essais nucléaires, l’exposition est minime. Et des milliards de dollars de dommages et intérêts disparaissent.

Tchernobyl n’est pas une fin. De l’explosion de la première bombe nucléaire au Nouveau-Mexique jusqu’à très récemment les tests en Corée du Nord, c’est un continuum d’événements radioactifs. Tchernobyl est un pic d’accélération, mais il y a d’autres accélérations importantes. Mais tous ces évènements sont liés parce que les autorités utilisent un événement nucléaire pour argumenter sur un autre événement nucléaire.
Vous soutenez que lors de l’accident nucléaire de Fukushima, la réaction des autorités japonaises été assez similaire à celle des autorités soviétiques lors de Tchernobyl. Dans quelle mesure ?
Vous savez, quand nous ne tirons pas les leçons de l’Histoire, nous les répétons et nous n’avons donc pas la chance d’en tirer des leçons. Le principal effort de la part des fonctionnaires de Moscou, de la part de certains fonctionnaires des agences onusiennes a été d’essayer de clore chapitre sur Tchernobyl, de réduire au minimum l’évaluation des effets sanitaires, d’interrompre tout type d’études à long terme à grande échelle sur les effets sur la santé. Leur argument est que si le bilan est faible, nous pouvons vivre avec ce genre de risques. Je pense que cela a permis aux Japonais de minimiser les efforts de prévention contre les tsunamis à Fukushima. Les générateurs de secours de la centrale sont tombés en panne après le tsunami, et il n’y avait rien pour refroidir les trois réacteurs qui ont fini par entrer en fusion. C’était une grande catastrophe prévue, mais pas évitée.
Chiffres clés
- 5,4 millions d’habitants affectés en Ukraine, au Bélarus et en Russie selon un rapport de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) de 2007
- De 55 à 200.000 décès causés par Tchernobyl, survenus immédiatement ou des années plus tard (cancers, maladies des rayons…). L’imprécision des chiffres est liée à l’absence d’études à grande échelle, notamment pour quantifier les effets des faibles doses.
- 2070-2080 Date à laquelle la zone d’exclusion de 30 km sera à nouveau habitable, selon Kiev. Les 10 km autour de la centrale ne pourront jamais être repeuplés.
- 124.423 touristes ont visité la zone d’exclusion en 2019. Un tourisme encadré et sans danger, en plein boom avant la pandémie.
Propos recueillis et traduits par Clara Marchaud.
Photo d’illustration : les lotissements de la ville de Pripyat, à côté de la centrale, et située dans la zone évacuée. (Crédit photo : Jorge Franganillo)
Notes
| ↑1 | La limite légale d’exposition à la radioactivité en France est de un millisievert (mSv) par an, 20 mSv chez les travailleurs du nucléaire. |
|---|
