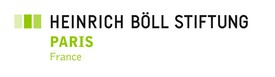Le Courrier d’Europe centrale a réalisé cinq longs entretiens avec des survivants de la ville martyre ukrainienne de Marioupol. Nous leur donnons la parole pour raconter ce qu’ils et elles ont vécu pendant le siège et les assauts des forces russes : la peur, la faim, la soif, la mort, la cruauté, mais aussi la solidarité.
Première partie : Le siège
Kristina Manko
Kristina Manko, manucure dans la jeune trentaine, nous a reçus dans l’appartement pragois où elle a trouvé refuge avec son fils Timour et sa belle-mère Iryna.
Kristina : « J’ai été réveillée par les sirènes à 6h du matin le 24, tout le monde s’est levé. Je devais aller au travail à 8h. Mon fils est allé promener le chien. Vous comprenez, nous sommes en guerre depuis huit ans et il n’y a pas eu de combats dans la ville à part quelques bombardements des banlieues en 2014. C’était juste une fois. Bref, on croyait qu’ils allaient tirer un peu dans les banlieues, et c’est tout. Nous étions tellement sûrs que tout allait se faire avec une certaine mesure, que personne ne viendrait bombarder les civils. »
« À partir du 28 février, tout le monde se cachait dans les caves, mais chez nous, il n’y en avait pas vraiment. Des amis qui sont partis le 24 nous avaient donné les clefs de leur appartement dans le centre pour nourrir les poissons et arroser les plantes, et ils nous ont dit d’emménager chez eux, qu’ils avaient une bonne cave. Par après, nous avons pu apprécier leur cave, bien sûr. Un autre avantage de cet appartement, c’était la cour de l’immeuble, avec un grill et des bûches, parce qu’à partir du 2 mars, nous n’avions plus ni eau, ni électricité, et le gaz a été coupé le 3. »

« Nous avons rassemblé toute la nourriture, toutes les réserves de tous les appartements, au maximum, parce qu’on avait de l’argent, mais il n’y avait plus de magasins, ils étaient fermés. Les gens ont commencé à piller les magasins déjà le 28 février. La police était encore en service et essayait d’agir, mais on ne peut pas juger ces gens, ils volaient surtout par besoin. »
« Les gens comprenaient que rien n’ouvrirait, que rien ne serait importé, nous savions déjà que la ville était fermée. Nous avions deux voitures, assez pour notre groupe de huit personnes, mais nous savions que personne ne nous laisserait passer. C’était un siège, un véritable siège. »
« Vous ne savez pas où ils tirent, parce que quand vous sortez, tout autour de vous, vous entendez des tirs, partout, comme si vous bouilliez dans un chaudron, des tirs sans fin, sans fin, ça ne s’arrêtait pas. Mais le plus effrayant dans tout ça, c’était la nuit quand on était couchés et le ‘spectacle’ commençait, avec des roquettes, des tirs, la défense anti-aérienne, les canons. Tu te dis, ça va, là c’est loin, mais quand tu entends le moteur de l’avion qui te survole, que tu es allongé sur ton matelas, et que tu ne sais pas où il est sur le point de lâcher sa bombe. Tu entends juste un ‘boum’, et tu te dis ‘Bon, c’est pas nous, c’est plus loin.’ »
« Il fallait trouver de l’eau, on comprenait qu’il n’y en aurait bientôt plus, et tous les jours il fallait sortir et trouver de l’eau, ne serait-ce qu’une bouteille, on se contentait de n’importe quoi. »
Kristina Manko
« Nous ne faisions aucun plan d’ailleurs. Nous allions nous coucher et notre seul objectif était de nous réveiller, nous réveiller et exister encore un jour, être vivants. Le matin, quand le matin arrivait, alors nous pouvions planifier quelque chose, en général la recherche d’eau, de nourriture, et peut-être même aider quelqu’un. »
« Il fallait trouver de l’eau, on comprenait qu’il n’y en aurait bientôt plus, et tous les jours il fallait sortir et trouver de l’eau, ne serait-ce qu’une bouteille, on se contentait de n’importe quoi. Quand tu marchais dans les rues, tu rencontrais des gens et tu faisais du troc. Par exemple, tu as du gruau, quelqu’un a du thé, ou des bonbons. Personne ne voulait d’argent, nous en proposions et ils disaient ‘Mais non, qu’est-ce que je vais faire avec ton argent ?’ »
« Un jour que j’étais partie à la recherche d’eau, je vois trois femmes approcher et je vois mon amie Liouda, qui habite de l’autre côté de la ville et avec qui j’étais en contact jusqu’à ce que les téléphones cessent de marcher. Elle a commencé à pleurer et à crier que tout flambait dans leur quartier, leur immeuble de neuf étages avait brûlé, le voisin avait été tué. Il faut dire qu’on était tous ébranlés par ce qu’on voyait : tout était détruit, des débris partout, des corps, des cadavres, certains recouverts, d’autres pas. Nous l’avons recueillie chez nous. »
« Nous sommes passés au Théâtre de Marioupol un jour avant qu’il ne soit bombardé. Il était si plein qu’on ne pouvait même pas y mettre un pied. Vous ne pouvez pas imaginer la quantité d’enfants qu’il y avait, c’était comme lors d’une fête foraine. Tout le monde des quartiers détruits y avait emmené leurs enfants. Il était écrit en grandes lettres ‘ENFANTS’. Il y avait des femmes, des enfants. Il n’y avait pas un soldat, ça c’est sûr. Alors, pourquoi ? Qu’est-ce que c’est que cette cruauté ? »
Iryna (la belle-mère) : « Au tout début, j’ai raconté un conte aux enfants, pour qu’on suive sa morale. Deux grenouilles tombent dans une jarre de lait. Elles se démènent pour nager et rester à la surface, elles se démènent, mais une abandonne, coule vers le fond et se noie. L’autre continue à se démener, à se démener, et elle bouge tant qu’elle transforme le lait en beurre. Elle grimpe sur le beurre et réussit à sauter hors de la jarre. Je leur ai dit : ‘Les enfants, il faut se démener et on s’en sortira’. Et quand nous perdions espoir, nous ne nous le rappelions l’un, l’autre : ‘Il faut se démener, comme la grenouille !’ »

Maria Vdovitchenko
Maria Vdovitchenko, 17 ans, devait finir le lycée en juin, mais la guerre l’a forcée à l’exil dans l’UE avec ses parents et son petit frère. Elle nous parle au téléphone.
« Avant le début de l’invasion, nous ne voulions pas croire à une guerre. Il n’y que ma mère qui disait tous les jours que ça allait arriver. Nous avions seulement acheté une cage pour le chat pour la calmer, en cas de fuite. Le 24 février, ma mère est rentrée dans ma chambre à 4 heures du matin et m’a dit : ‘La guerre a commencé’. Ce sont les mots les plus terribles que j’aie entendus et des explosions ont suivi. Nous vivions dans le rayon Prymorskyi [sud-ouest de Marioupol, sur la rive], le quartier le plus sûr, le plus caché, mais déjà à ce moment-là nous avons senti les explosions. »
« Une énorme panique a éclaté, les gens se sont mis à tout acheter dans les magasins, faire le plein avec leurs voitures, partir. C’est comme s’ils avaient oublié les règles de base, comme s’ils avaient oublié de rester des êtres humains. Les magasins ont commencé à être pillés. Le premier jour, on a voulu partir, mais les combats faisaient rage et la ville était déjà bouclée. Et c’est comme ça que le blocus de Marioupol a commencé. »
« Dès les premiers jours, l’eau a été coupée. Il n’y avait ni signal téléphonique, ni électricité, ni chauffage, même le gaz a été coupé. On ne pouvait cuisiner que dans la rue, sur des feux improvisés, mais les bombardements n’arrêtaient pas et c’était dangereux. Nous n’avions pas eu le temps de faire des réserves de nourriture et nous n’avions même pas d’abri anti-bombe. Notre seule cachette était la salle de bain dans notre immeuble. Les bombardements n’arrêtaient pas. Nous tendions l’oreille : parfois c’était loin, parfois c’était près. »
« Nous avons compris que ça ne durerait pas trois-quatre jours, que c’était beaucoup plus sérieux. Et moi j’ai compris que ma vie d’avant était finie. Tous mes rêves, tous mes espoirs anéantis. On était tellement abattus, nous ne nous attendions pas à cette guerre, nous n’avions rien fait, nous ne l’avions pas commencée, mais nous pouvions mourir à tout instant. Je me suis rendue compte qu’on détruisait ma ville natale, où j’ai grandi, où je suis allée à l’école, où j’ai eu mes premières amours… »
« Je ne sais pas ce qui était pire, comprendre qu’on pouvait mourir d’une bombe à tout moment, ou être incapable de dormir à cause de la faim, de la soif. »
Maria Vdovitchenko, lycéenne de 17 ans.
« Nous nous sommes cachés comme ça jusqu’au 2 mars, quand les tirs ont commencé à être plus rapprochés. Les obus ont commencé à tomber dans les appartements voisins, la maison tremblait, les meubles, les lustres. Nous nous sommes rués dans la salle de bain. Après un court silence, nous avons entendu un sifflement et le souffle d’une explosion nous a cloués au sol. Assourdi, aveuglés, choqués, nous étions pris de panique. Je criais, je criais très fort. J’ai compris que nous pouvions mourir là à l’instant. Les étages supérieurs commençaient à tomber, c’était terrible. Nous nous sommes traînés vers la sortie. »
« Nous sommes entrés dans le premier immeuble, vers la première cave. Nous frappions et nous pouvions entendre des chuchotements, mais ils ne nous ouvraient pas. Puis, un homme a ouvert et a dit qu’il ne pouvait pas nous laisser entrer, qu’il n’y avait pas la place. Papa ne l’a pas écouté, il l’a poussé et nous sommes entrés par force. Il y avait vingt personnes déjà, ils nous regardaient avec haine. Nous avons passé douze jours dans cette cave, nous avions à peine de quoi manger, et les gens ne se comportaient pas humainement les uns avec les autres. Tout le monde comprenait que les réserves allaient venir à manquer. »
« Les bombardements n’arrêtaient pas, c’était dangereux de sortir. Nous avons appris ce qu’était la faim. Je ne sais pas ce qui était pire, comprendre qu’on pouvait mourir d’une bombe à tout moment, ou être incapable de dormir à cause de la faim, de la soif. À un moment donné, il ne nous restait qu’un bout de pain qu’on a partagé en quatre. Je n’ai même pas pu le manger, je ne pouvais plus digérer, et j’avais peur de ne plus rien avoir. Une nuit, le cœur de ma mère s’est arrêté, elle était malade et la maladie avait empiré. Nous n’avions pas de médicaments. Papa l’a sauvée en lui faisant de longs massages cardiaques. »
« Parfois, l’espoir s’évanouissait complètement. Nous étions dans le vide, nous ne savions pas ce qui se passait à la surface, ce qui se passait dans le monde. Nous entendions de nouveaux bruits, comme des trains au-dessus de nous, et puis tout a tremblé, même sous nous. C’était une nouvelle arme, très puissante. Maintenant je sais que c’était le jour où la flotte russe a bombardé Marioupol. Les gens étaient terrifiés, c’était comme si des insectes s’infiltraient, nous avions des sueurs froides. À ce moment, j’ai compris que nous allions mourir, j’en étais sûre. Je ne voulais pas voir la souffrance de mes proches et j’ai prié Dieu qu’il nous donne une mort douce. »
Lioubov Golovtchenko
Lioubov Golovtchenko, entraîneuse de sport, travaillait à Kyïv avant la guerre. Atteinte de la Covid-19, elle avait décidé juste avant l’invasion d’aller passer sa quarantaine dans sa ville natale de Marioupol, chez sa jeune fille. Lioubov a depuis trouvé refuge en Estonie, d’où elle nous raconte.
« Le coronavirus m’a sauvé, puisqu’il m’a emmené vers Marioupol. Sinon, je serais devenue folle, avec ma fille à Marioupol et moi à Kyïv. »
« Quand le gaz et l’électricité ont été coupés, on a commencé à cuisiner sur des feux. Mais eux, quand ils voyaient des feux et des rassemblements de gens, ils commençaient à bombarder, les avions bombardaient. J’ai été touché par un éclat de bombe, un homme s’est fait arracher le crâne. Il m’a couvert, et moi j’ai couvert ma fille qui était à côté. Il m’a protégé de son corps. On n’a même pas pu l’enterrer, parce qu’ils bombardaient sans cesse. Plus tard, quand un trou d’obus assez large s’est formé, on y a mis tous les corps, on a écrit les noms. Plusieurs personnes sont mortes de notre immeuble, sept ou huit. Et plusieurs ont été blessés. »
« Sous mes yeux, un garçon de 16 ans a été tué alors qu’il tentait de faire un feu. »
Lioubov Golovtchenko, coach sportive.
« Moi, après la bombe, je me suis réveillée dans la cave. J’avais un éclat dans la tête, et un dans mon cou, près de la carotide. J’avais perdu beaucoup de sang et j’avais perdu connaissance. Pendant deux jours, je ne savais pas où j’étais, je me suis réveillée avec ma fille qui pleurait sur moi. J’ai essayé de me lever, mais je n’y arrivais pas. Comme j’avais survécu deux jours, les gens m’ont dit que je vivrai. »
« Tous les hôpitaux avaient été détruits par les bombes, et il y en avait une autre, mais les Russes y étaient déjà, donc on n’a pas voulu y aller. La bombe, c’était le 16 mars, puis le 23, les Russes nous ont fait sortir de la cave sous la menace de leurs armes. »
« Avant ça, quand on a voulu fuir de la cave, on n’a même pas pu sortir. On ne pouvait plus sortir pour cuisiner sur le feu, puisqu’il y avait un tireur d’élite sur un des toits. Ils tuaient les civils, ils les fusillaient depuis le toit. Sous mes yeux, un garçon de 16 ans a été tué alors qu’il tentait de faire un feu. »
Roman Agachkov
Roman Agachkov, employé au port de Marioupol, a dû fuir avec sa femme et sa fille de quelques mois en passant par la Russie. Il nous parle au téléphone depuis Narva, en Estonie, quelques heures après avoir franchi la frontière.
« Quand la guerre a commencé, mon bébé n’avait même pas six mois. À Marioupol, ça a commencé à tirer du côté est, plus près des positions de la DNR [la république auto-proclamée de Donetsk]. Nous vivons de l’autre côté de la ville. Nous vivions. Une amie du côté est a déménagé chez nous dès le début, avec sa fille de 8 ans. Mais après, chaque jour c’est devenu de plus en plus bruyant, de plus en plus terrifiant. D’abord, l’électricité a été coupée, puis l’eau, le jour suivant, je crois. Et le chauffage, évidemment. Le gaz, c’était le 7 ou le 8 mars. »
« Jusque-là, il n’y avait pas de tir sur notre immeuble de neuf étages, mais ça a commencé à tirer depuis ce côté-là quand les Russes ont pris le village de Staryi Krym [sud-ouest de Marioupol]. Ça a commencé à tirer de là, c’est à environ 15km de chez nous et ça tombait près de chez nous. À ce moment, on devait souvent sortir, pour couper du bois dans la cour, pour cuisiner, dans la rue. On habitait encore dans notre appartement jusqu’au 10 mars environ. Les fenêtres étaient intactes et ça allait, même s’il faisait très froid à l’intérieur. Mais le 10, tout a été fracassé et nous sommes descendus dans la cave, avec des matelas, des couvertures. »
« Environ une heure plus tard, des avions russes ont commencé à survoler notre immeuble. Il n’y avait pas de militaires ukrainiens dans notre coin, il n’y en a jamais eu. Je suis un Marioupolien, je connais la ville, il n’y a pas de base là, il n’y en a jamais eu. Et l’avion a tout simplement largué sa bombe à côté de notre immeuble et de deux autres. Des gens sont morts, quelqu’un s’est fait arracher la jambe, toutes les fenêtres ont été soufflées, pas juste les carreaux. Tout le monde s’est réfugié à la cave. »
« On y est restés environ 12 jours, je ne suis même pas sorti de la cour de l’immeuble. On cuisinait entre les étages dans l’immeuble. On avait trop peur de sortir, parce qu’il y avait des bombardements, des tirs de mortier, ça tombait près de nous. Ceux qui s’aventuraient plus loin nous racontaient qu’il y avait des cadavres dans les rues, des membres qui gisaient. Moi et ma femme nous ne sommes allés nulle part, juste sortir jeter un coup d’œil à notre immeuble. Puis un obus est tombé dedans, dans les étages du haut. Et tout ça venait du côté d’où les Russes attaquaient, de l’autre côté il n’y a eu aucun impact. »
« Nous n’avions aucun signal téléphonique, aucun contact, rien. Nous ne savions rien sur ce qui se passait dans le pays, dans notre ville même. Comment évacuer la ville, par où aller ? Un peu avant, j’avais encore la radio sur mon portable, on écoutait les nouvelles ukrainiennes. Puis, un jour, je me réveille et j’entends la radio russe, les nouvelles russes, ces propagandistes comme Solovïov. Ça m’a terrifié parce que j’ai compris qu’ils occupaient la ville, qu’ils bloquaient nos stations, qu’ils encerclaient nos troupes. »
Ksenia
Ksenia, nom d’emprunt pour une jeune mère, qui préfère taire son vrai nom pour éviter des ennuis à sa famille restée à Marioupol. Elle a pu fuir par la Russie et trouver refuge en Europe, d’où elle nous a parlé.
« Vous savez, j’ai l’impression que je n’ai pas l’histoire la plus intéressante à raconter, parce que j’ai eu de la chance, tout s’est passé d’une façon plus légère que pour beaucoup de mes amis. Nous avons été sauvés par le fait que notre famille a depuis toujours travaillé dans la gastronomie. Chez nous, nous avions quelques réserves de nourriture. »
« Notre quartier a été bombardé dès le début. Le 26 février, un premier missile a atterri chez nous, et puis ça n’a pas arrêté, jusqu’à la toute fin, on pouvait à peine mettre le nez dehors. Au début, ils ont coupé l’électricité, le téléphone, l’eau, puis le gaz. Nous ne pouvions plus cuisiner à l’intérieur, il fallait aller dehors. Après trois jours, les magasins étaient fermés. Le pillage a commencé, les gens ont commencé à tout prendre eux-mêmes. Nous nous sommes préparés, nous avions peur que des pilleurs viennent chez nous. »
Nous avions 35 personnes dans notre cave, notre famille et des amis, et beaucoup d’enfants. Le mien n’a même pas deux ans. Mon père nous a nourris, nous tous, 35 personnes, et puis aussi les voisins, pendant toute la guerre. Et les gens venaient aussi nous demander de la nourriture, et nous leur donnions ce que nous pouvions. Évidemment, nous devions rationner, c’était peu, mais assez pour survivre. »
« Dans la ville, c’était une véritable catastrophe humanitaire. Les autorités ukrainiennes avaient organisé des abris, des entrepôts avec des réserves et des points d’aide humanitaire. Mais des informateurs ont passé l’information aux Russes et ils ont presque immédiatement détruit tous ces endroits. Mon amie s’y trouvait et a dû s’enfuir sous les bombes, il n’y avait que des civils. La ville s’est retrouvée sans réserves. »
« Quand tout ça s’est fait détruire, les militaires sont venus nous dire qu’ils allaient ouvrir les magasins. Enfin, les ouvrir de force. Ils ont pris quelques hommes et ils ont saisi tous ces produits pour les remettre aux gens. Sans ça, les gens n’auraient pas survécu. C’était terrible, il n’y avait presque rien, les gens buvaient l’eau des radiateurs, nous ramassions de la neige. »
« Il faisait très froid, nous dormions tout habillé. Quand j’y repense, c’est complètement inhumain ce qu’ils nous ont fait vivre. »
Ksenia.
« Ils bombardaient tous les jours, notre quartier a été bombardé très violemment. Plusieurs bombes sont tombées dans notre cour. Un obus a détruit d’un coup cinq de nos voitures, et nous n’avions plus rien pour partir. Toutes les vitres avaient été fracassées, déjà le 27 février il n’y avait plus une fenêtre à l’immeuble. »
« Il faisait très froid, nous dormions tout habillé. Quand j’y repense, c’est complètement inhumain ce qu’ils nous ont fait vivre. Et encore, moi je vivais avec mes proches, nous avions de la nourriture, tandis que d’autres erraient dans les rues et devaient demander aux autres. Les gens ont commencé à aller d’un appartement à l’autre pour chercher de la nourriture, à fouiller dans les ruines. Ils n’avaient pas le choix. »
« Plus tard, les Russes ont commencé à tirer sur les appartements, ils combattaient contre des tireurs, ils répondaient à coups d’obus de chars. Nous avons vu leurs chars tirer sur les immeubles, détruire des immeubles de neuf étages. Mon appartement a complètement brûlé, l’obus est tombé directement dedans, la maison de ma mère a aussi été complètement détruite. Ce n’est que par miracle que la maison où nous étions réfugiés ne s’est pas écroulée. Vous ne pouvez pas vous imaginer, il ne reste quasiment plus un mur debout dans la ville. »
« Les soldats ukrainiens et puis russes sont venus chez nous pour contrôler, nous criions qu’il y avait des enfants, seulement des enfants et des personnes âgées. Il y a eu une fusillade dans notre cour, nous étions cachés dans la cave et nous pouvions entendre les bruits de course sur les toits, les grenades qui explosaient. Ce n’est que par chance que nous avons survécu. »
Article publié avec le soutien de Heinrich Böll Stiftung | Bureau Paris – France.