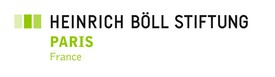Tania, Lioudmyla et d’autres volontaires confectionnent des gilets pare-balles dans un petit atelier quelque part en Transcarpatie. Une illustration frappante de la levée en masse de la société ukrainienne contre l’occupant russe.
Les mains minutieuses occupées à coudre la sangle d’un gilet pare-balles, Tania interrompt soudain son travail. Dehors, les arbres bourgeonnent sous le soleil printanier tardif des Carpates ukrainiennes. Sa voix se fait tremblante, ses yeux s’embuent. « Ils ont compris que papa ne rentrerait peut-être jamais », confie-t-elle à voix basse, couverte par le bourdonnement des machines à coudre. La maman parle de ses trois enfants de 8, 11 et 13 ans. « Quand ils me posent la question, c’est très dur », dit cette femme de 44 ans au visage jovial, en reprenant son paisible ouvrage. Dans une guerre qui s’éternise, en raison de laquelle des millions d’Ukrainiens ne peuvent pas rentrer chez eux, mères et enfants se retrouvent loin de leur père et mari depuis de longs mois. « C’est très dur d’être seule, ils veulent tous voir leur père très vite », dit Tania, impuissante. Son mari est mobilisé à l’Est du pays, là où les combats font rage.
Ce qui lui permet de tenir, c’est cette mission « qu’elle n’arrêtera pas avant la fin de la guerre » : concevoir chaque jour entre 20 et 30 gilets pare-balles pour protéger « nos gars » de l’enfer. Dans cet atelier monté à l’improviste par des hommes réfugiés et le maire de la commune de Pylypets, isolées à plus de 600 mètres d’altitude dans les Carpates, elles sont une dizaine de femmes autochtones, et déplacées surtout, à vivre pareille souffrance. « Quand il y a du réseau on s’appelle, mais parfois ça coupe et on ne peut plus parler, c’est dur, raconte Tania. Et encore je ne me plains pas car cette femme derrière moi, elle n’a plus de nouvelles de son mari depuis de nombreux jours, elle se fait un sang d’encre ». En Transcarpatie, un demi-million de déplacés se sont réfugiés au plus fort de la guerre. Si depuis ils sont nombreux à être rentrés chez eux ou à avoir fui au-delà des frontières, des centaines de milliers y vivent encore, faute d’alternative.

Sans leurs parents depuis quatre mois
A côté de Tania, Lioudmyla a le regard éteint. Cette femme originaire de Kyiv est mère et grand-mère. Mère d’une fille militaire, mobilisée depuis le 24 février – premier jour de l’invasion russe – avec son mari sur le front Est. Et grand-mère de deux petits-enfants qui n’ont pas vu leurs parents depuis plus de quatre mois, si ce n’est en vidéo. Elle se demande parfois quand ils pourront les revoir : « ils veulent tout le temps rentrer à la maison, et le soir quand je rentre, ils pleurent énormément, alors pour les calmer je leur dis que leurs parents les protègent ». Le père, sergent originaire de Louhansk, avait déjà été envoyé à Bakhmout dans le Donbass en 2017.
Devant chaque couturière, une machine bourdonne. L’austérité des gilets pare-balles contraste avec l’innocence des fresques enfantines au mur et des chaises taille miniature qui accueillaient encore des écoliers il y a quelques mois. Veronika (son prénom a été changé), grisonnante et fatiguée, vient d’arriver il y a deux jours dans l’atelier. Depuis peu, elle habite à l’étage, avec son mari, dans une pièce aménagée par la mairie et mise à disposition gratuitement. « Nous louions une chambre pas loin d’ici, mais comme nous ne savons pas combien de temps cette guerre va durer, et si nous aurons assez d’économies pour les prochains mois, on a préféré venir vivre ici », explique cette musicienne originaire de Kharkiv, grande ville de l’Est du pays, où les bombardements ont repris il y a peu. La mairie assure que plusieurs centaines de logements de logements gratuits sont encore vacants, pour ceux qui n’ont plus les moyens de payer.

« Quand les avions russes ont survolé notre maison j’ai cru que c’était fini pour notre maison, c’est là qu’on a décidé de partir », raconte Veronika d’une voix monocorde. C’était début mars. Mais l’angoisse, désormais, vient des territoires occupés par les Russes. Sa fille et ses quatre enfants y sont coincés depuis de nombreuses semaines. Dans cette ville de l’oblast de Zaporijjia occupée tôt par envahisseurs, il y a bien eu des corridors pour ceux qui voulaient fuir, mais « ils n’étaient pas sûrs », affirme Veronika. « Il arrive qu’ils tirent sur les gens, il n’y a même pas la possibilité de faire acheminer de la nourriture car ils ont déjà tué des conducteurs ». Elle tremble à l’idée de livrer une quelconque information qui pourrait permettre d’identifier sa fille, qui essaye depuis de nombreuses semaines de fuir. « Son mari a hésité à partir les premiers jours, et après, c’était déjà trop tard », se lamente-t-elle. « J’ai très peur pour ma fille car on ne sait pas ce qui peut lui arriver avec les Russes ». Le désespoir se lit parfois dans ses yeux.

« Sa maison a été totalement détruite »
Cet atelier de gilets pare-balles raconte cette guerre à sa façon. Il raconte d’abord comment cette entreprise de destruction a évolué depuis le 24 février : la violence avec laquelle elle anéantit le quotidien des uns, et épargne désormais celui des autres. Mais elle reste mouvante et les équilibres, précaires. Entre les machines à coudre, les destins se croisent mais n’ont parfois pas grand-chose en commun. « Une femme nous a quittés il y a quelques jours pour rejoindre l’Allemagne, une autre la Suisse, tandis qu’une troisième est rentrée chez elle », raconte Ivan, le jeune architecte énergique qui a lancé l’atelier. « On avait aussi une femme d’Irpin avec nous, mais sa maison a été totalement détruite, elle n’a plus de chez elle, alors elle est partie à Oujhorod – la capitale de la Transcarpatie – où elle a déplacé son entreprise ». Tant bien que mal, chacune poursuit avec ce qui lui reste de la vie avant-guerre, quand il ne faut pas totalement la reconstruire.

Lioudmyla a eu plus de chances. A Kyiv, elle n’a rien perdu. Alors depuis maintenant de nombreuses semaines, son entreprise a rouvert. Ses deux associés, engagés dans les groupes de défense territoriale de la capitale ukrainienne, ont repris le travail sur place. Car à Kyiv, la vie reprend peu à peu son cours. La demande y est très forte. Et pour cause, elle vend du matériel de couverture de toit. « On a beaucoup de clients en ce moment, car énormément de gens sont rentrés chez eux et reconstruisent leurs toits très endommagés », assure-t-elle. A Kyiv, à Vinnytsia, Jytomyr ou encore dans l’oblast de Lviv. « Je travaille à distance, mais je n’ai pas prévu de revenir avec mes petits-enfants, car ils sont effrayés à cette idée », confie cette grand-mère aimante, comptable de son entreprise.
Partie 1 : Dans les Carpates ukrainiennes, le rôle clé de l’agriculture vivrière dans l’accueil des déplacés
Partie 2 : La cohabitation parfois tumultueuse entre déplacés et autochtones dans les Carpates ukrainiennes
Avec les moyens du bord
Dans ces circonstances incertaines, l’atelier raconte aussi l’exceptionnelle capacité d’adaptation et d’improvisation des Ukrainiens un peu partout dans le pays, souvent avec les moyens du bord, depuis le début de cette guerre. « La nouvelle version est très professionnelle, chaque deux semaines on améliore le prototype », dit Ivan en montrant un gilet pare-balles abouti. Lui, son collègue Vitaly et leurs femmes respectives, Natalia et Olha, ont tout appris sur le tas, à force de vidéos, de lectures et de persévérance. Et puis ils ont montré comment s’y prendre aux femmes volontaires qui se sont présentées à l’atelier. Aujourd’hui, elles « travaillent de 5 à 6 jours par semaine de 10 à 18h », et « on les paye ce qu’on peut quand on en a les moyens », précise l’architecte originaire de Kyiv, qui s’était installé dans le village quelques mois avant la guerre.

Les financements viennent eux des dons, obtenus sur Instagram à force de publications, de généreux entrepreneurs contactés par le maire du village qui ont acheté du matériel, et de l’argent parfois versé par ceux qui reçoivent les gilets. Prix de chaque gilet : 2 000 hryvnias (65 euros). « Beaucoup de gens de tout le pays sont venus voir le maire du village et lui ont dit “on a de l’argent, comment on peut aider”, ou alors “est-ce que je peux faire quelque chose pour aider ?” » », raconte Ivan. Pour ce qui est des plaques de métal des gilets, « on a récupéré les suspensions des vieux camions soviétiques du coin, et on les a soudés. Puis on a utilisé des perforateurs de blindage pour tester la résistance aux balles ».

Un couple d’habitants du village a joué un rôle essentiel : il a dessiné les gilets, et choisi les machines, « car c’est son métier ». Il a trouvé et soudé les plaques de métal. La débrouille qui sauve des vies a partout essaimé en Ukraine. Dans l’atelier, Alina, 23 ans, des ongles et un tee-shirt aux couleurs de l’Ukraine, est fière d’y participer : « Aujourd’hui, je peux aider, je suis une patriote depuis que mon frère a fait son service militaire, et après le déclenchement de la guerre dans le Donbass en 2014, cela m’a sensibilisé, mais à l’époque j’étais trop jeune pour comprendre et pour aider », confie la jeune femme, comme pour rappeler que la guerre, qui a pris dans ses cordes toute une génération d’Ukrainiens, fait des ravages dans le pays depuis huit ans maintenant.
Face à ce drame sans fin, Tania, assise en face, fait un constat : « quand nous sommes tous unis, notre nation devient spéciale, c’est dans le sang de nos concitoyens de s’entraider. On ne peut pas faire moins, on en a absolument besoin ».
Article publié avec le soutien de Heinrich Böll Stiftung | Bureau Paris – France.