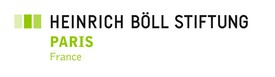Chaque jour, dans un décor bucolique de cerisiers en fleurs, de poules qui picorent et de jardins vivriers à peine labourés, c’est le même rituel, dans le village de Nijnie Selichtche, aux pieds des Carpates ukrainiennes. Reportage.
Oblast de Transcarpatie, Ukraine – Chaque jour, dans un décor bucolique de cerisiers en fleurs, de poules qui picorent et de jardins vivriers à peine labourés, c’est le même rituel, dans le village de Nijnie Selichtche, aux pieds des Carpates ukrainiennes. Aux alentours de midi, puis six heures plus tard, lorsque la lumière baisse, les familles de déplacés empruntent les pavés qui serpentent jusqu’au restaurant Geleta pour venir s’y nourrir gratuitement. C’est ici, dans ce restaurant aux poutres sombres et aux airs traditionnels que l’élan de solidarité qui traverse depuis le début de la guerre ce petit village reculé de 3 000 âmes s’est le mieux illustré. Chaque jour, pendant des semaines, des dizaines d’habitants défilaient pour donner leur production vivrière. 130 déplacés venaient s’y remplir le ventre. La Transcarpatie, région frontalière de la Hongrie, accueille aujourd’hui autour de 400 000 personnes fuyant l’invasion russe.

Dans le village, alors que plusieurs familles, originaires de la région de Kyïv, de Kharkiv ou d’ailleurs ont retrouvé leur terre ou ont rejoint l’Europe ces derniers jours, ils sont aujourd’hui moins nombreux. Mais le restaurant transformé en cantine humanitaire continue de jouer son rôle. Les gérants, Inna et son père Petro Prygary, malgré les traits tirés après plus de trois mois de guerre et de multiples initiatives (acheminement d’aide, évacuations, logement) ne comptent pas interrompre l’effort collectif, tant qu’il y aura des déplacés en demande d’aide. « Il se peut que la guerre dure encore très longtemps, et que l’on doive alimenter ces réfugiés pendant plusieurs mois encore », anticipe Petro Prygary, qui s’assure, avec sa fille, que les produits soient consommés avec parcimonie, notamment la viande, plus rare. Les cochons, par exemple, donnés par son associé français Oreste del Sol qui tient une ferme au sein de la communauté Longo Maï – une communauté autosuffisante et d’inspiration anarchiste très présente en Europe de l’ouest – ne sont servis que de temps à autre dans les assiettes.
« Je ne peux pas faire autre chose que cela alors que nous sommes en guerre »
Inna Prygary
« Les premières semaines, les agriculteurs locaux ont amené énormément de produits de leur potager ou de leurs animaux : des pieds de cochon, des œufs ou des légumes. Ça a un peu baissé dernièrement, mais ils continuent à venir de temps en temps », explique cet homme autoritaire, qui possède également la fromagerie voisine et un magasin de produits locaux. Sinon, ce sont surtout un donateur suisse qui envoie chaque mois 500 euros, les réseaux Longo Maï Europe, et les réserves de sa fromagerie, ouverte il y a vingt ans, qui permettent à la cantine d’exister.
Au menu aujourd’hui, dans les assiettes des réfugiés, un potage de pommes de terre et des choux farcis à l’oignon et aux carottes, accompagnés de riz. A table, des mères aux visages marqués par la lassitude d’une guerre qui a trop duré, des enfants, dont un groupe d’orphelins, et quelques pères qui ont, pour diverses raisons – notamment lorsqu’ils ont au moins trois enfants -, pu échapper à la mobilisation générale décrétée au début de la guerre par le gouvernement ukrainien.

En cuisine, Inna Prygary donne les consignes aux employées et aux volontaires, elle sert, débarrasse, s’enquiert des nouveaux arrivés, et du nombre de plats servis. « Je ne peux pas faire autre chose que cela alors que nous sommes en guerre », dit simplement cette jeune femme de 28 ans, visage sérieux encadré par des lunettes noires, qui emploie encore quinze personnes dans ses trois affaires, malgré la situation et l’arrêt de l’activité économique du restaurant.
200 micro-producteurs de lait
Entre les murs décrépis des modestes maisons qui dessinent le village, les paisibles âmes paysannes se lèvent aux aurores. Lorsque les meuglements de l’unique vache que chacun compte dans sa demeure ici se font entendre. Lorsque la brume matinale recouvre encore le clocher argenté de l’église orthodoxe récemment rénové. Une fois le pot de lait plein, la plupart se rendront à pied à la fromagerie en longeant la bande de goudron trouée de toutes parts qui traverse le village. Cinq matins par semaine, ce sont environ 200 micro-producteurs d’ici et des alentours qui viennent vendre leur production, au prix de 19 hrivnas le litre (60 centimes d’euro).

Micha, un sourire fait d’or et de longues années de travail, est venu à pied avec un pot à lait plein. Quand il ne trait pas sa vache, il est sur le toit de ce village très pieux, là-haut, sur le clocher perché en haut de la petite colline qui surplombe les potagers. C’est le sonneur du bourg. Pour lui comme pour les autres la dizaine de litres qu’offre chaque matin sa vache n’est pas négligeable, surtout en temps de guerre. Dans la fromagerie aussi, on sait combien le pécule est vital en ces temps incertains. « Sans ce travail je ne pourrais pas faire vivre ma famille », dit Nadia, 43 ans dont douze dans la fromagerie, et mère de trois enfants. Grâce au travail des sept fromagères, la fabrique continue de tourner, et d’alimenter en fromages le magasin de produits locaux qui lui fait face, et en trésorerie le restaurant devenu cantine, tous propriétés de Petro Prygary et de sa fille.
Distribution de tubercules de pommes de terre
Dans le magasin de producteurs voisin, occupée à servir du fromage, une jeune femme aux longs cheveux châtains, d’une énergie débordante, respire mieux depuis quelques semaines. « Je suis très reconnaissante envers Inna de m’avoir donné ce travail », confie Aliona Salnikova, réfugiée d’Izioum et de l’enfer qu’elle a côtoyé pendant plusieurs jours dans cette ville de l’Est de l’Ukraine aujourd’hui occupée par l’envahisseur russe. Son salaire fait vivre son grand-frère, qui ne trouve pas de travail, et sa mère.


Bénévole au sein du restaurant pendant plusieurs semaines, elle a été embauchée suite au départ d’une des employées locales partie rejoindre son mari en Tchéquie. Dans les Carpates, beaucoup ont fait de même, car dans ces montagnes, des dizaines de milliers d’autochtones partent travailler tous les ans plusieurs mois dans les pays d’Europe centrale (Tchéquie, Slovaquie, Pologne) où les salaires sont bien meilleurs. Ici le labeur est surtout agricole, ou mal rémunéré – le salaire minimum est de 150 euros mensuel – dans les usines de la petite ville de Khoust. Difficile pour les réfugiés, dans ces conditions, de trouver un gagne-pain.
C’est précisément afin d’assurer la résilience de cette région déjà densément peuplée que Petro Prygary et des membres de la communauté Longo Maï ont fait acheminer 18 tonnes de tubercules de pommes de terre et quelques centaines de kilos de maïs. Le jour de la distribution, des dizaines de grands-mères couvertes d’un châle, de grands-pères à la dentition abîmée et quelques jeunes couples du village se pressent devant la benne du camion qui vient de se garer dans la cour de la fromagerie. Ici court la rumeur que « ces pommes de terre d’Autriche seraient plus résistantes que celles qu’on a l’habitude de planter chaque année ». Alors on veut bien les essayer. Chacun est venu avec son sac en toile et repartira avec l’équivalent de deux seaux remplis. « L’idée, en distribuant ces pommes de terre et ce maïs, c’est d’anticiper les prochains mois car les réserves ont fondu avec l’arrivée de tous ces gens, et également de renouveler les semences », explique Petro Prygary.
« Si on veut tous pouvoir manger, nous n’avons pas le choix »
Danilo Grichka
Danilo Grichka charge tant bien que mal ses deux gros sacs de pommes de terre sur son vélo grinçant. Du haut de ses 85 ans, élégamment vêtu d’une veste grise vestige d’un autre temps, col de chemise de sortie, et d’un béret noir surmontant son étroit visage, cet ancien garde-parc de la région lance avec aplomb, en mimant des tirs de mitraillette : « on est obligés de planter plus de pommes de terre que d’habitude parce que c’est la guerre, si on veut tous pouvoir manger nous n’avons pas le choix ».

« Ici, les superficies labourées ont presque doublé ces derniers temps, assure Petro Prygary, d’habitude les gens cultivent leur lopin mais pas forcément en totalité ». A une centaine de mètres de là, alors que depuis deux jours la pluie laisse un peu de répit aux labours, l’heure est aux semailles. Rostik, 22 ans, en temps de paix étudiant en médecine à Kyiv, répand soigneusement du humus en guise d’engrais sur les tubercules de pommes de terre germées aux côtés de sa mère chez qui il est revenu vivre en raison de la guerre. Cette année ils sèmeront 5 ares de légumes, de féculents et de maïs. Soit 20 % de pommes de terre en plus, et deux tiers de plus de maïs que l’année dernière.
« Nous plantons davantage car nous ne savons pas combien vont coûter les céréales, les féculents et les légumes cette année, et quelle sera la situation humanitaire dans les mois à venir, explique Rostik, les pieds entre deux sillons, et si on n’a pas besoin de toutes les pommes de terre que nous plantons nous les donneront aux réfugiés, ou à d’autres ». Le jeune homme aux yeux bleus, le regard décidé à intégrer bientôt la médecine militaire, se rappelle son enfance : « quand mon père – qui travaille aujourd’hui en République Tchèque – était là et mon grand-père encore en vie, nous avions trois champs, un pour les pommes de terre, un pour le maïs et un autre pour les légumes ». Si l’agriculture vivrière a perdu du terrain dans la région ces dernières années, elle reste un pilier de l’alimentation locale. Autour de lui, une dizaine de champs labourés sont en train d’être semés, surplombés par une forêt parsemée de cerisiers en fleurs.
Un peu plus loin, Vassylina Kustyna, 65 ans, et les siens préparent la terre pour les pommes de terre d’Autriche qu’ils ont reçues. Elle devrait donner 500 kilos. De quoi nourrir les six membres de la famille et « avoir un surplus en cas de nécessité ». Eux frôlent l’autosuffisance : les pâtes et le riz sont pratiquement les seuls produits qu’ils achètent. Un atout en temps de guerre.


Un groupe de femmes
A dix kilomètres d’ici, le petit village de Zolotar’ovo est accessible via une piste infernale de terre et d’ornières larges comme un ruisseau. Elle grimpe entre les pruniers en fleurs et les Lada cinquantenaires garées devant les vieilles demeures des quelques courageux qui vivent là. Une fois la colline franchie, il faut bifurquer au niveau d’une chapelle orthodoxe exubérante, dont les dorures contrastent avec la rusticité des environs. Le bourg, ses 4 500 habitants et sa poussiéreuse maison de la culture – aujourd’hui un dépôt de vêtements pour les déplacés – accueille aujourd’hui 700 âmes en exil. L’aide a pris ici d’autres formes.
Un groupe d’une quarantaine de femmes venues de quatre villages alentour se mobilisent tous les jours pour cuisiner des plats locaux, qui sont livrés cinq jours par semaine à deux heures et demie de route à la gare d’Oujhorod, la capitale de la région, qui voit encore passer des dizaines de réfugiés chaque jour. « Dès le début de la guerre j’ai constaté qu’il y avait des problèmes d’approvisionnement en nourriture à la gare d’Oujhorod », raconte Natalia Kovach, habitante de 42 ans hyperactive du village, qui a ouvert il y a peu une petite fromagerie. « On m’a expliqué que là-bas les volontaires n’avaient pas le temps de cuisiner, du coup j’ai écrit sur les réseaux sociaux ce qu’il manquait, j’ai demandé aux gens de Zolotar’ovo d’amener des plats chauds, et ils l’ont fait ». Cela ne s’est plus arrêté.



Depuis ces femmes se relaient pour préparer quotidiennement des dizaines de kilos de salades olivier (betterave, pommes de terre, mayonnaise) des beignets, du pain perdu, des œufs durs, des feuilletés à la viande de porc, des côtelettes ou encore des Holoubtsi (des feuilles de choux farcies avec de la viande hachée, des carottes et du riz).
« La majeure partie de ce qu’on cuisine provient des potagers des habitants de notre village, de nos animaux, et de nos caves où tout le monde a des zakroutky (conserves de toutes sortes) en quantité ici » détaille Natalia Kovach, mère de quatre enfants, dont la plus grande, Anastasia, 22 ans, a quitté son travail pour venir l’épauler. Le reste des ingrédients, elles et d’autres habitants impliqués se le procurent avec leurs propres économies.
« Cela me rend heureuse de voir cette solidarité »
Malgré une guerre qui s’éternise, l’enthousiasme pour aider n’a pas disparu. « Ma mère, qui est une vieille dame de bientôt 70 ans, m’a appelé la dernière fois et m’a dit : qu’est-ce que je suis contente de pouvoir aider, et de voir autant de gens le font aussi, cela me rend heureuse de voir cette solidarité », raconte, presque émue, Natasha Dovganytch, restauratrice du village impliquée dans le groupe.
Pour Liessa Popp, assise à ses côtés, employée de l’école du village, l’énergie consacrée aux déplacés s’inscrit dans le message de la Bible : « c’est un devoir pour nous, catholiques, d’aider ceux qui sont dans le besoin avec les fruits de notre terre », dit cette femme très pieuse, qui se rend à la messe chaque semaine, dans ce village à majorité orthodoxe. Si, partout dans les très traditionnelles et pieuses Carpates le devoir de charité a été accompli par des habitants concernés, la rencontre et la cohabitation entre l’Ukraine des villes digitalisées et de l’Ukraine des campagnes laborieuses n’est pas vierge de tensions, d’incompréhensions et d’un sentiment d’injustice. Loin s’en faut.
A lire dans le prochain épisode…
Article publié avec le soutien de Heinrich Böll Stiftung | Bureau Paris.