Ils sont nombreux à avoir été contraints à l’exil, faute de pouvoir exercer librement dans leur pays en pleine dérive totalitaire. Comment les journalistes bélarussiens parviennent-ils à informer sur la situation dans leur pays depuis l’étranger ? Témoignages.
(Varsovie, correspondance) – L’étau se resserrait inéluctablement, au rythme implacable des salves de répression. C’était au printemps 2021, un peu moins d’un an après le soulèvement inédit, réprimé violemment par le satrape de Minsk, Alexandre Loukachenko, réélu frauduleusement ce 9 août 2020. Après les opposants politiques, tantôt emprisonnés, tantôt forcés à l’exil, voilà que les médias indépendants bélarussiens s’apprêtaient à subir, à leur tour, les foudres de la machine à répression. Le média en ligne Tut.by – désormais renommé Zerkalo (Miroir, en russe) – a d’abord été liquidé ; une large partie de son équipe, écrouée. Nastassia Roŭda en avait alors conscience : « bientôt, notre tour viendrait ».
Il fallait faire un choix pour la Bélarussienne de 27 ans, aujourd’hui directrice de la rédaction du journal Nacha Niva.[1]Nacha Niva (Notre domaine, en bélarussien) était le journal du renouveau politique et culturel bélarussien à Vilnius au début du XXe siècle. Il a été ressuscité en 1991 lors de l’indépendance du Bélarus et a toujours été une voix importante de la dissidence à la dictature de Loukachenko. Édité en bélarussien, le journal résiste aussi à la russification engagée sous les tsars, puis poursuivie sous le régime soviétique et relancée par Loukachenko après un bref intermède. Ou bien rester au pays, et ainsi risquer la prison à son tour, ou bien se destiner à l’exil. En mai de la même année, décision est prise pour elle de trouver refuge à Vilnius, en Lituanie voisine — l’un des principaux foyers d’exode, avec la Pologne, de la dissidence bélarussienne. « Et, quelques mois plus tard, les perquisitions commençaient dans nos bureaux », poursuit-elle.

« Deux de nos collègues arrêtés il y a plus d’un an croupissent toujours derrière les barreaux : ils ont été condamnés à deux ans et demi en colonie pénitentiaire. Depuis juillet 2021, au moment où la vague de répression s’est amplifiée contre la presse indépendante au pays, tout le monde a compris que faire du journalisme au Bélarus, c’est risquer de se retrouver au cachot. Toutes ces années en prison perdues, les prisonniers politiques ne pourront pas se les approprier à nouveau une fois libérés. Et la prison bélarussienne, ce n’est pas un sanatorium : c’est un système bien rodé de torture, physique ou psychologique. Nous n’avons pas le droit moral de forcer les journalistes de notre rédaction à continuer à travailler sur un tel terrain. »
Censure d’État, arrestations par centaines au nom de prétextes patentés… Jamais il n’a été aussi dangereux d’exercer ce métier depuis 1994, année de l’arrivée au pouvoir de Loukachenko. La crispation totalitaire qui a suivi la révolution avortée d’août 2020 s’est même amplifiée avec la guerre en Ukraine. La « quatrième plus grande prison de journalistes au monde », comme le qualifie l’ONG Reporters sans frontières — une trentaine y sont toujours derrières les geôles du régime — se distingue d’ailleurs « par un nombre élevé de femmes journalistes derrière les barreaux ». Seuls les propagandistes du média d’État BTRC ne sont pas inquiétés d’être réduits au silence. « Dans le contexte actuel, très peu de personnes sont prêtes à prendre le risque d’exprimer leurs opinions et d’exercer leur liberté d’expression, écrit Anaïs Marin, rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme dans ce pays, dans son dernier rapport présenté en octobre à l’Assemblée générale de l’ONU. Qui souligne néanmoins qu’« un grand nombre de journalistes bélarussiens restent dans le pays malgré la répression permanente ».
« Personne ne pensait que Poutine allait envahir l’Ukraine, et nombreux sont ceux qui espéraient un changement rapide au Bélarus. »
Nastassia Roŭda
La quasi-totalité des médias indépendants ayant été liquidés, c’est depuis l’étranger qu’il est possible d’informer. Selon l’Association des journalistes bélarussiens (BAJ), qui a aussi été bannie sur le territoire bélarussien, ils sont au moins 400 journalistes, comme Nastassia Roŭda, à avoir quitté le pays. La rédaction de Nacha Niva, éparpillée ici et là en Europe, continue son travail d’information en ordre dispersé. Non sans obstacle. Celui du financement, qui repose beaucoup sur les dons de lecteurs, reste non négligeable. Auquel s’ajoute l’incertitude de la vie en exil : « Le plus dur, c’est cette responsabilité et cette obligation, comme journalistes, de tenir malgré tout », confie Nastassia Roŭda. « Les Bélarussiens ayant été forcés d’immigrer sont privés de leur pays, et la majorité a cessé de faire des plans sur le long terme. Personne ou presque ne pensait que Poutine allait envahir l’Ukraine, et nombreux sont ceux qui espéraient un vent de changement politique rapide au Bélarus, en août 2020. Nous devons continuer d’exercer notre métier en dépit de cette réalité. » Informer à propos des développements de la guerre en Ukraine, évoquer la répression qui se poursuit au Bélarus, « comprendre et ressentir les humeurs au sein du pouvoir »… Nacha Niva, qui reste l’un des plus anciens journaux bélarussiens, a aussi une autre vocation bien particulière, qui relève de la conscience nationale. « Populariser l’histoire Bélarus, d’être gardien de la culture et la langue bélarussiennes. »
Informer depuis l’exil
Mais comment maintenir sa pertinence auprès d’un lectorat se trouvant dans un pays où on ne peut plus mettre les pieds ? « C’est un énorme défi, car plus longtemps nous sommes à l’étranger, plus le risque d’être coupés de la réalité du terrain augmente », concède au bout du fil Hanna Liubakova, journaliste indépendante originaire de Minsk, exilée depuis 2020.
À Nacha Niva, relate Nastassia Roŭda, « nous avons été dans les derniers à sortir du pays, ce qui nous a peut-être donné l’occasion, comme journalistes, d’assister aux premières vagues de répression ». Et de ressentir « cette crainte que l’on sent dans sa chair quand on sort de la maison, quand on sonne à la porte ou qu’un numéro inconnu s’affiche sur le téléphone. » Or, pour maintenir le lien avec les soucis du quotidien « on écrit à nos proches, familles et amis sur place, en demandant ce qui leur importe. Lire les médias de propagande, malgré la manipulation qu’ils diffusent, peut aussi être une manière de lire entre les lignes. »

Malgré l’exil, le journal Nacha Niva continuer de lever voile sur les coulisses du pouvoir autoritaire. Comme en octobre, lorsqu’il a révélé en la venue d’une « mobilisation cachée » au Bélarus, visant à accroitre le soutien militaire à son allié russe (pour l’heure, l’armée bélarussienne n’a néanmoins pas été impliquée directement dans le conflit en Ukraine). C’est aussi Nacha Niva qui a fait savoir, en mai 2022, que plusieurs librairies au Bélarus ont été enjointes de retirer de leurs rayons le livre 1984 de George Orwell, sous l’ordre du régime. « L’interdiction de 1984, on l’a appris comme ça, par nos sources. On incite les gens qui sont témoins d’événements ou d’éléments d’intérêt public à nous écrire. On fait aussi des appels à témoignages : partager vos expériences de vie, raconter le quotidien… » Mais le climat de terreur a instillé une crainte de témoigner qui se fait de plus en plus présente, relève-t-elle.
Même pour un média bien rodé à l’exil comme Belsat, les difficultés d’informer à distance demeurent. La télévision bélarussienne, qui émet depuis quinze ans à Varsovie, en Pologne, ne peut plus compter sur son réseau de correspondants au Bélarus : eux aussi, forcés à l’exil ou derrière les barreaux. À commencer par Katsyaryna Andreïeva qui, en juillet, été condamnée de nouveau à huit années de prison pour « trahison d’État ». « On ne pensait pas qu’on en arriverait comme au temps de Staline », déplore Aliakseï Dikavitsky, directeur adjoint de la rédaction de Belsat. La répression au Bélarus, puis l’invasion russe en Ukraine, un pays où s’étaient déjà réfugiés nombre de Bélarussiens, a constitué tout un défi logistique pour le média. Des dizaines d’employés ont rejoint les bureaux de Belsat dans la capitale polonaise en l’espace d’à peine deux ans. « Certains sont encore traumatisés, on doit leur donner accès à des thérapies, enseigner le polonais. »
Il a fallu adapter les manières de présenter l’information : comment présenter des bulletins télévisés en n’ayant plus de journalistes sur place ? « Les images, c’était encore possible il y a deux ans, désormais, la caméra au Bélarus, c’est terminé », souligne Aliakseï Dikavitsky. « Heureusement, les téléphones portables peuvent parfois faire le travail, et des citoyens nous envoient également beaucoup de contenu. On doit bien sûr les vérifier, car les services secrets sont actifs et pourraient envoyer de fausses vidéos. Pour tout média en exil, c’est bien sûr compliqué de tout couvrir. Mais on diversifie les méthodes, en puisant dans nos sources gouvernementales. On utilise Telegram de manière très précautionneuse, tandis que les communications par courriel ou téléphone, c’est terminé c’est fini. »
« Quiconque collabore avec notre journal d’une façon ou d’une autre est passible d’emprisonnement de sept ans au Bélarus. »
Nastassia Roŭda
Corollaire : le concept du « journalisme citoyen » a pris une « place de taille au Bélarus », abonde Hanna Liubakova. « Tant de personnes sur place envoient de l’information, notamment en lien avec le déplacement des troupes russes dans le pays. Il y a encore ce feu qui anime le cœur des Bélarussiens, et Loukachenko n’a pas été en mesure de tout détruire. Il faut cependant y aller avec prudence. Pour leur propre sécurité, certaines informations ne peuvent pas être divulguées au grand public, au risque de mettre en danger nos sources. »
La messagerie cryptée Telegram, très populaire au Bélarus, reste l’un des moyens de prédilection des journalistes pour communiquer avec ceux restés au pays. « Mais nous faisons également de la sensibilisation pour inciter les gens à se diriger vers d’autres plateformes plus sécuritaires, comme Signal, ou pour nous procurer un VPN », nuance Nastassia Roŭda, de Nacha Niva. « Et nous essayons de masquer le plus possible les circonstances pouvant identifier quiconque nous envoyant du contenu, et ainsi que les autorités. » Car elle sait que la publication d’une information peut se révéler fatale. Le régime s’est volontiers servi des photos et vidéos diffusées lors des manifestations de 2020 pour mieux traquer les opposants par la suite, usant probablement de logiciels de reconnaissance faciale.
Une menace qui plane, même à l’étranger
L’exil n’est pas non plus dénué de danger. Le détournement d’un vol qui a mené à l’arrestation du journaliste et opposant Raman Pratassievitch, en mai 2021, est venu le rappeler d’une manière fulgurante. Hanna Liubakova l’admet : prendre l’avion ne la rend pas sereine. « C’est toujours un élément que l’on doit garder en tête : nous sommes encore dans la mire [du régime]. Je suis toujours sur la liste de personnes recherchées, ce qui limite le nombre de pays dans lesquels je peux me rendre. »
Une menace que Nastassia Roŭda atteste. « Nos déplacements sont possiblement pistés. Et quiconque collabore avec notre journal d’une façon ou d’une autre est passible d’emprisonnement de sept ans au Bélarus. » En cause : le journal est qualifié par Minsk d’organisation « extrémiste ».D’où le fait que les articles publiés par Nacha Niva ne sont jamais signés de la plume des journalistes.
Article publié avec le soutien de Heinrich Böll Stiftung | Bureau Paris – France.
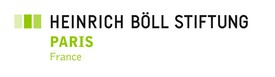
Notes
| ↑1 | Nacha Niva (Notre domaine, en bélarussien) était le journal du renouveau politique et culturel bélarussien à Vilnius au début du XXe siècle. Il a été ressuscité en 1991 lors de l’indépendance du Bélarus et a toujours été une voix importante de la dissidence à la dictature de Loukachenko. Édité en bélarussien, le journal résiste aussi à la russification engagée sous les tsars, puis poursuivie sous le régime soviétique et relancée par Loukachenko après un bref intermède. |
|---|
