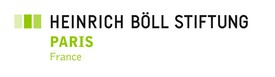Natalia vit en France depuis près de dix ans. Le 23 février au soir, quelques heures avant que la Russie n’envahisse le pays, elle est retournée en Ukraine et arrivée à Kyiv pour forcer sa famille à quitter la capitale. Elle n’en est pas repartie depuis. Ukrainiennes dans la guerre (4/4).
C’est peut-être l’une des dernières personnes à avoir foulé le sol de l’aéroport de Boryspil, le plus important du pays, situé dans la grande banlieue de Kyiv. Son avion a été l’un des derniers à atterrir dans la capitale ukrainienne, le 23 février, dans la soirée, alors que les compagnies aériennes annulaient leurs vols les unes après les autres. Elle n’a prévenu sa famille qu’avant de décoller de l’avion, à Naples, où elle avait transité depuis Toulouse, là où elle vit avec son compagnon français. Elle venait d’acheter un appartement dans le centre-ville de la cité occitane lorsqu’elle a senti « que la guerre allait prendre un autre tournant, que l’on passerait dans ce que j’appelle « la phase active », m’explique-t-elle autour d’un café dans l’un des endroits branchés de Podil, le quartier des hipsters de Kyiv.
La phase active selon cette femme de 37 ans, c’est celle qui a suivi l’annexion illégale de la Crimée en 2014 par la Russie, puis l’invasion déguisée dans le Donbass, région frontalière de Moscou, où les autorités russes soutenaient, de façon à peine voilée, les séparatistes des oblasts de Louhansk et de Donetsk. Celle qu’elle sent venir depuis des semaines, « qui n’était plus qu’une question de temps pour moi », et pour laquelle elle demande à sa famille, basée à Kyiv, de se préparer à la guerre totale qui allait avoir lieu. « Mes parents ne voulaient rien entendre. Ils n’envisageaient pas un instant de quitter leur maison, me raconte Natalia. J’avais beau leur dire de préparer une valise d’urgence, avec tous les documents nécessaires types passeport, traitement médical, etc., quelques affaires, un peu d’argent. Ils me rétorquaient qu’ils ne bougeraient pas de chez eux ». Elle sait qu’elle doit se rendre sur place pour les forcer à se préparer.

Le lendemain, les troupes russes envahissent le territoire ukrainien. Natalia et ses parents partent alors rejoindre sa sœur et ses enfants en périphérie de Kyiv, dans la grande banlieue nord de la capitale, juste avant la forêt qui sépare la ville des localités de Boutcha et d’Irpin. Elle ne se souvient plus très bien combien de temps ils restent tous barricadés dans la maison, « c’est difficile de me souvenir de cette période », me dit-elle, entre deux regards jetés aux notifications de son téléphone portable, qu’elle finit par mettre en silencieux « sinon on va être constamment dérangées », sourit-elle.
De cette semaine, « ou peut-être ces dix jours, reprend Natalia, elle garde seulement précisément en mémoire le fait que l’on devait aller dehors aux toilettes. Ma sœur n’avait pas eu le temps de faire appel à une entreprise pour s’occuper de la fosse septique. On n’avait pas d’autre choix que d’aller dans le jardin même si c’était dangereux, rit-elle nerveusement. Chaque fois qu’on sortait, on tombait sur les missiles qui passaient à 200 mètres de la maison. Tu finissais par savoir lesquels étaient russes et lesquels étaient ukrainiens ».
Retrouvez les 3 autres portraits de notre dossier spécial « Ukrainiennes dans la guerre » : Alisa Kovalenko, Oksana Leuta, et Oleksandra Matviichuk.
Durant ces journées en famille, Natalia commence à apporter son aide par tous les moyens via les réseaux sociaux. Elle appelle à faire des dons, les récolte, liste les besoins de premières nécessités à envoyer aux organisations caritatives qui les apportent ensuite aux soldats volontaires : des garrots tourniquets, des compresses stériles, des lampes frontales, des chaussures, des duvets. Déjà, à cette période, elle est parmi les siens sans être vraiment présente. « Je passais mes journées collée à mon ordinateur. J’avais besoin de me sentir utile, de faire quelque chose ».
Alors que les tanks russes s’approchent de Boutcha et d’Irpin, l’ex-mari de sa sœur, engagé dans l’armée, ordonne à la famille de quitter la ville pour se réfugier plus au centre du pays chez des amis. Mais Natalia a déjà pris sa décision : elle ne partira pas avec eux. Pour elle, le chemin se fait en direction du centre-ville de Kyiv, où elle possède son propre appartement. « Ma mère m’a dit : je viens avec toi, je ne te laisse pas retourner là-bas seule, explique cette Ukrainienne installée en France depuis 2015. Elle pleurait, me suppliait de partir avec eux, poursuit-elle, les mains tremblantes, mais pour moi, c’était impossible ».
Elle ne sort que tous les trois jours pour acheter de l’eau, et vit au rythme des bombardements.
Retour dans la capitale donc, sans ses amies, sans sa famille, sans personne, dans une ville vidée de plus de la moitié de ses habitants. « Je me devais d’être auprès de mon pays dans la tragédie qu’il vit actuellement. C’est comme être au chevet d’une personne malade. Je me dois de lui tenir la main, je ne peux pas le laisser tomber ». Elle s’inscrit sur une liste de volontaires auprès du Silpo le plus près de chez elle, – l’une des enseignes ukrainiennes de supermarchés, afin d’aider à réapprovisionner les rayons alors que la majorité du personnel a fui la ville. Elle propose également aux personnes âgées ou dans l’impossibilité de quitter Kyiv, de faire des courses pour elles : apporter de l’eau, des conserves, des médicaments. Elle informe ses voisins qu’elle est là en cas de besoin, « et pas seulement s’il faut jeter des Cocktails Molotov par la fenêtre », rit-elle de nouveau nerveusement. Elle reste aussi très active sur les réseaux sociaux où elle commence à renseigner les volontaires étrangers, Français en premier lieu, souhaitant rejoindre la Légion internationale que l’Ukraine a créé au lendemain du 24 février. « Ce n’était pas clair de savoir auprès de qui il fallait postuler, quels documents ils devaient fournir pour rejoindre les rangs de l’armée, quel type de contrat ils devaient signer, à quelle compensation financière ils pourraient avoir droit, explique-t-elle, en frottant régulièrement ses épaules. Je faisais la navette entre eux, l’ambassade d’Ukraine en France et le ministère de l’Armée pour obtenir des informations et leur fournir ensuite ».
Elle ne dort plus, ou difficilement, dans la chambre de fortune qu’elle s’est aménagée dans ce qui lui sert de dressing en temps de paix, loin des fenêtres, pour se préserver en cas de bombardement, avant de finir par regagner son lit. Tant pis pour les risques. « Ce n’était plus possible de dormir à même le sol avec le froid qu’il faisait ». Elle ne sort que tous les trois jours pour acheter de l’eau, et vit au rythme des bombardements. Elle ne mange « que des sandwichs au saucisson que je me prépare en vitesse, alors que ce n’est pas du tout le régime alimentaire que j’ai en France », jusqu’à tomber malade. Covid, puis burn-out. « Je n’arrivais plus à lire, à voir même les touches de mon écran d’ordinateur ».
Elle s’arrête quelques jours pour se reposer, mais reprend très vite ses activités en tant que bénévole. Fin mars, elle rejoint un groupe de volontaires qui achète du matériel militaire pour les soldats bénévoles qui ne font pas parti de l’armée régulière. Gilets par balles, casques, uniformes, drones, longues vues, lunettes de visions nocturnes.
Elle n’arrête pas, jusqu’à un nouvel épuisement.
Sa famille est désormais réfugiée chez elle, à Toulouse, dans l’appartement qu’elle a acheté avec son compagnon. Natalia part les rejoindre quelques semaines en juin. Elle est sous anxiolytiques lorsqu’elle consulte un psychiatre qui lui conseille de ne pas retourner en Ukraine. Elle fait fi de ses conseils et retourne, seule, à Kyiv, trois semaines plus tard. « Je savais que je ne devais pas, mais c’était irrationnel, plus fort que moi, sourit-elle. Mes racines sont ici, se justifie-t-elle. Les fleurs, tu peux les couper et les déplacer, mais les racines, tu as beau tout faire contre, elles restent. C’est comme ça, je ne peux pas faire autrement. »
Aujourd’hui, elle continue de récolter le matériel nécessaire « pour aider à gagner la guerre plus rapidement », même si elle est épuisée et qu’elle a conscience qu’elle devrait revenir en France. « Je sais que je serais plus efficace car en réalité, tout ce que je fais, je le fais à distance depuis mon ordinateur. En plus, je n’ai pas de rentrée d’argent depuis février, j’ai mis mon travail en stand-by depuis le 24 février », m’explique-t-elle. Free-lance dans le domaine de l’édition à Toulouse, elle a contracté un prêt en Ukraine alors même qu’elle a déjà un crédit conséquent à rembourser chaque mois pour son appartement en France. « J’ai épuisé toutes mes économies, me confie-t-elle, je n’ai plus de réserves ». Le 8 septembre, elle devait prendre son avion à Varsovie pour rejoindre la France. Elle n’est pas montée dedans. « Mon compagnon m’a dit : « tu veux briser notre équipe ? », me dit-elle fébrilement, avant d’énoncer à haute voix, comme si elle se parlait à elle-même, « de toute façon, c’était déjà compliqué avant le 24 février… » Elle culpabilise davantage d’abandonner sa patrie. Alors qu’une sirène coupe notre entretien, elle confie : « lorsque je suis allée à Lviv quelques jours au printemps pour aider mes parents à quitter le pays, je culpabilisais de ne plus entendre les sirènes ».
Article publié avec le soutien de Heinrich Böll Stiftung | Bureau Paris – France.