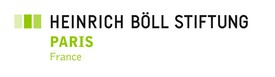Alisa Kovalenko est une des plus célèbres réalisatrices ukrainiennes de sa génération. A 34 ans, elle a été primée dans différents festivals internationaux tels que le Festival international du film documentaire d’Amsterdam. Son dernier film, Home Games, a été nommé meilleur documentaire de l’année 2019 par l’Académie ukrainienne du Film. Le 24 février dernier, elle a posé ce qui lui servait d’arme jusque-là, sa caméra, pour rejoindre la ligne de front en tant que combattante. Ukrainiennes dans la guerre (3/4).
Samedi soir à Kyiv, durant la contre-offensive menée par l’armée ukrainienne dans la région de Kharkiv, début septembre. Alors que le moral des Ukrainiens est au plus haut face aux spectaculaires avancées des troupes ukrainiennes en cours au nord du pays, Alisa Kovalenko n’a pas le cœur à la fête. Cette célèbre réalisatrice ukrainienne, membre de l’Académie européenne du cinéma, vient d’apprendre la mort d’un de ses plus proches amis de l’unité de soldats à laquelle elle appartenait. Elle sait le prix à payer pour la libération de ces territoires et in fine, la victoire de son pays. Elle sait qu’il est élevé. Ce samedi soir, alors que la jeunesse ukrainienne est de sortie dans la capitale et qu’elle profite des dernières heures avant le couvre-feu, Alisa n’arrive pas à se réjouir. Elle pleure son frère d’armes.
Elle est fatiguée par cette guerre, qui, elle en est convaincue, sera longue. Pas seulement parce qu’elle ne dort pas bien la nuit car ses « amis morts au combat viennent me rendre visite dans mes rêves ». Pas seulement parce qu’elle est encore hantée par les bombardements incessants dont elle a réchappée quand elle était au front, et par les heures passées dans les tranchées où elle a cru ne jamais revoir son fils de 5 ans. Comme beaucoup de soldats et de vétérans de cette guerre, celle enclenchée le 24 février dernier, mais qui dure en réalité depuis 2014 lorsque les combats ont éclaté dans le Donbass entre séparatistes pro-russes soutenus par Moscou et troupes ukrainiennes, elle doit vivre avec ses traumatismes. Ces blessures invisibles à première vue, qui sont pourtant bien présentes. Mais la jeune femme n’a pas le temps de consulter un psychologue pour soigner ces traumatismes, elle a trop à faire.
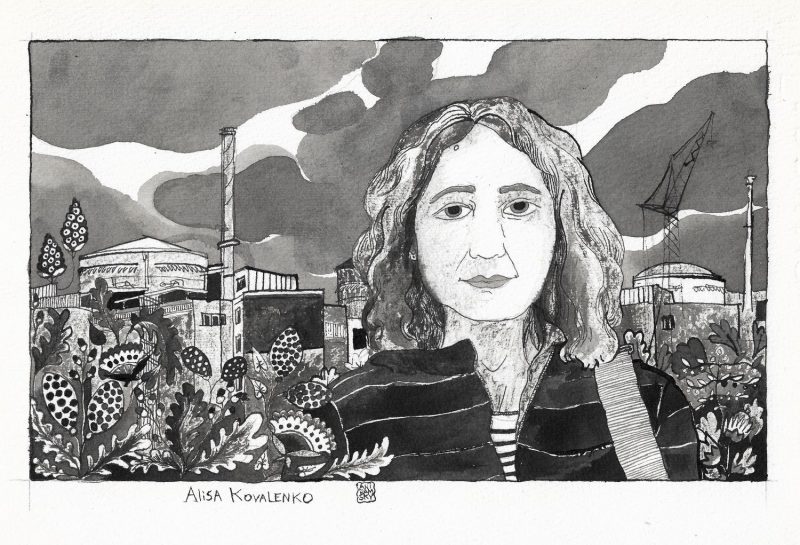
Depuis la révolution de la Dignité en 2014, où elle est place Maïdan chaque jour « en tant que réalisatrice, mais avant tout en tant que citoyenne pour changer la société civile », souligne-t-elle, elle n’a jamais cessé de combattre. Elle ne s’est pas arrêtée un instant de documenter les événements qui avaient lieu dans son pays. Lorsque la guerre éclate en 2014 à l’est de l’Ukraine, peu après l’annexion illégale de la Crimée par la Russie, la réalisatrice part sur la ligne de front filmer un bataillon de soldats volontaires. Elle est fascinée par ces civils qui du jour au lendemain, ont mis de côté leur vie pour défendre leur patrie. « Ils étaient architectes, professeurs, ingénieurs, c’était incroyable de les observer se muer en combattants », raconte-t-elle. « Ils sont rapidement devenus mes amis. A cette époque, j’avais une certaine distance grâce à ma caméra, poursuit la jeune femme, mais je me suis promis que si la guerre prenait un autre tournant, si ma ville natale, Zaporijja, (NDLR : à l’est de l’Ukraine, située à environ 50 km de la mer d’Azov), était touchée, je prendrais moi aussi les armes ».
« J’ai posé ma caméra, je n’arrivais plus à filmer. J’avais besoin de me sentir utile ».
Ce qui la convainc d’autant plus, ce sont les quatre jours qu’elle passe en captivité aux mains des séparatistes. Elle est enlevée alors qu’elle suit les soldats ukrainiens du côté de Kramatorsk et de Slaviansk. « Ils étaient persuadés que j’étais une combattante. Ils n’arrêtaient pas de dire : « Elle ne pleure pas, c’est sûr, elle est sniper. D’ailleurs, regardez ses chaussures, ce sont des baskets de sniper », sourit-elle amèrement. Elle est interrogée pendant des heures par les services de contre-intelligence russe, qui tantôt la menace de lui couper les doigts, tantôt lui inflige des violences sexuelles. « Mais je n’ai pas envie d’en parler », dit-elle pudiquement. Elle a brièvement évoqué ce qu’elle a enduré dans son premier documentaire, Alisa in Warland, celui qui l’a fait connaître et dans lequel elle raconte comment elle est passé de l’autre côté de la caméra : de réalisatrice témoignant de la réalité de son pays, à actrice de cette guerre. Dans son regard, il n’y a pas de place pour l’apitoiement.
Elle reprend : « quand la Russie a envahi l’Ukraine le 24 février, je me trouvais déjà dans le Donbass pour le documentaire que je réalisais. » Un film pour lequel elle suit le parcours d’adolescents issus de villages situés à l’époque près de la ligne de front, du côté de Zolote, et qui s’apprêtent à partir au Népal pour un voyage d’alpinisme : leur rêve. « J’ai posé ma caméra, je n’arrivais plus à filmer, dit-elle sans marquer de pause à son récit. J’avais besoin de me sentir utile, je ne pouvais pas simplement être spectatrice de la situation. J’ai aidé mes personnages à évacuer la zone alors qu’ils ne voulaient pas quitter leur village ». Si elle est parvenue à en convaincre certains de partir, elle est sans nouvelles d’autres depuis près de trois mois.
Retrouvez les 3 autres portraits de notre dossier spécial « Ukrainiennes dans la guerre ».
Le choc des premiers jours passés, Alisa Kovalenko rentre à Kyiv pour se porter volontaire auprès de l’armée. Elle se fait recaler. « J’ai alors contacté le commandant du bataillon que je suivais depuis 2014, et avec qui je n’ai jamais cessé d’échanger, raconte-t-elle posément. Je lui ai dit que je voulais être des leurs. Quand je suis arrivée à leur base, je lui ai dit : « Je ne suis pas venue filmer. Je suis là pour combattre ». Au début, il a refusé, il n’a rien voulu entendre, poursuit la jeune femme, mais je suis restée. Au fur et à mesure, j’ai eu des tâches à réaliser en tant que soldat, je faisais mes preuves lors des entraînements, et petit à petit, j’ai eu de plus en plus de responsabilités. J’ai fini par signer un contrat en tant que membre de l’opération spéciale au sein des Forces spéciales. Au final, c’était mieux que l’armée régulière pour moi. J’étais avec un bataillon de volontaires que je connaissais et en qui j’avais entièrement confiance ». Grâce à ce contrat, Alisa a aussi l’assurance de ne pas s’engager de manière indéterminée, jusqu’à ce que la guerre se termine, même si elle ne perçoit pas de salaire. Les volontaires n’ont en effet aucune compensation financière. Ni sur le terrain le temps des combats, ni après, qu’ils reviennent vivants ou non à la vie civile.

Son compagnon a beau tenter de la raisonner, la réalisatrice part pour quatre mois sur le front. Il sait qu’il n’a d’autre choix que de la soutenir face à sa détermination. Le plus dur pour elle, confie-t-elle, a été de dire au revoir à son fils. « Je lui ai expliqué que je partais me battre pour lui, pour qu’il puisse vivre dans un pays indépendant. Il m’a demandé : « Maman, pourquoi tu dois aller combattre ? Pourquoi toi, et pas une autre ? » Je lui ai répondu : « Parce que si tout le monde réagit comme ça, qui défendrait le pays et te permettrait d’être libre quand tu seras grand ? ». Il a compris, mais il ne m’a pas lâché la jambe pour autant. Il ne voulait pas que je parte. » La mère doit alors ruser pour détourner l’attention de son fils d’elle, et pouvoir quitter l’appartement. « Je fuyais mon fils pour aller sur la ligne de front !, déplore-t-elle, c’était absurde. J’avais honte, mais je ne pouvais pas faire autrement, j’ai fait ce que j’avais à faire ».
Malgré le poids de la guerre, tant physique que psychologique, – « imagines porter un équipement militaire qui pèse une tonne, plus une arme qui est tout aussi lourde alors que tu te fais canarder, que tu dois courir, plonger à même le sol pour te protéger, te cacher », lâche cette femme menue du haut de ses 1,60 cm et 50 kg, – elle veut déjà repartir sur le front. Sa seule crainte lorsqu’elle a enfilé l’uniforme en mars était « que mon fils ne me reconnaisse pas, ou qu’il m’en veuille, avoue-t-elle. Mais il m’a sauté dans les bras quand je l’ai retrouvé, explique-t-elle, le visage soudain illuminé. J’étais rassurée, il ne m’avait pas oublié. Je n’étais pas une étrangère à ses yeux, il m’aimait toujours ».
« La génération de mon fils sera beaucoup plus libre. Je crois en elle, je me bats pour cela ».
Depuis son retour à la vie civile, en juillet dernier, elle ne pense qu’à retourner sur le front. Elle culpabilise d’être en vie, d’être revenue à une vie normale, de profiter d’un certain confort. Elle est pourtant « au bord du burn-out, tellement fatiguée que parfois, je n’arrive pas à trouver l’énergie de commencer la journée, raconte-t-elle. Sur le terrain, on te confie une tâche ou deux. C’est plus facile d’une certaine manière car tu es uniquement concentrée sur ce que tu as à faire, comme monter la garde. Ici, je suis à la fois une mère, une épouse, une réalisatrice, une fille qui doit prendre soin de ses parents. Je dois faire des machines, répondre aux mails, prendre les rendez-vous médicaux pour ma mère. J’ai une charge mentale énorme. Au bout de quelques jours, je me suis dit : « mais comment j’ai réussi à faire ça avant ? », rit-elle.
Son retour à la vie quotidienne s’explique aussi par la volonté de terminer le film qu’elle était en train de réaliser avant le 24 février. « Même si aujourd’hui, le sujet n’est plus la réalisation d’un rêve pour ces adolescents ukrainiens, mais le fait de vivre avec ce rêve brisée », dit-elle. Elle veut tenir ses engagements auprès de ses producteurs et de ses soutiens, comme la chaîne Arte, et rendre au plus vite son dernier documentaire, avant de reprendre les armes. Si elle confie avoir « peur d’être heureuse car avec la Russie, tu ne sais jamais à quoi t’attendre, Poutine peut faire n’importe quoi. Je ne peux pas être heureuse tant que ce ne sera pas la victoire totale », elle en est persuadée : « La génération de mon fils sera beaucoup plus libre. Je crois en elle, je me bats pour cela ».
Article publié avec le soutien de Heinrich Böll Stiftung | Bureau Paris – France.