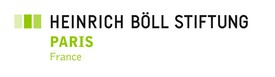C’est une radioscopie de la vie derrière les barreaux dans le Bélarus d’Alexandre Loukachenko. Daria Tchoultsova vient de purger près deux années de prison pour avoir fait son travail de journaliste. La Bélarussienne de 25 ans travaillant pour le média indépendant Belsat revient sur son arrestation, le procès bidon dont elle a été l’objet, ses conditions de détention ainsi que sa nouvelle vie d’exilée à Varsovie.
(Varsovie, correspondance) – Elle était devenue le visage d’une liberté de la presse bafouée, jetée en taule. Deux ans après son arrestation, la voilà enfin sortie des geôles bélarussiennes. Mais c’est l’impression de vivre dans un univers parallèle qui habite Daria Tchoultsova depuis sa libération, le 3 septembre. « Comment je vais ? Beaucoup me posent la question. À vrai dire, moi-même je ne sais pas ce que je ressens. Quand j’étais là-bas, je ne pouvais pas distinguer le réel de l’irréel. Et c’est encore le cas aujourd’hui. »
« Là-bas », c’est la colonie correctionnelle n°4 de Gomel, un camp de travail pour femmes, situé dans l’est du Bélarus. La journaliste de 25 ans vient d’y purger l’essentiel d’une peine de 657 jours pour « avoir porté gravement atteinte à l’ordre public ». Dans la dictature d’Alexandre Loukachenko, au pouvoir sans discontinuer depuis 1994, cela signifie exercer son travail de journaliste.
Sa silhouette timide apparait derrière le seuil de la porte. Longs cheveux châtain clair, tricot sur le dos, visage angélique, Daria reçoit, en cette matinée grise de novembre, dans son petit appartement de Varsovie. Autour d’un thé, Il faudra plus de quatre heures pour tout raconter. Raconter ce quotidien pénitentiaire, tributaire des humeurs des gardiens, mais aussi celui d’une liberté recouvrée, et empreinte de séquelles. Le 21 septembre, Daria Tchoultsova a rejoint la Pologne voisine, foyer d’exil de dizaines de milliers de dissidents bélarussiens. La seule façon de continuer à exercer son métier de journaliste sans risquer une nouvelle rafle policière.
À la fenêtre de sa chambre flotte le drapeau historique blanc-rouge-blanc, symbole de l’opposition démocrate bélarussienne, tandis que sur le rebord, jouxtée à une pile de livres, une statuette attire l’œil : il y a un an, pendant sa détention, Daria a été désignée lauréate pour le prix Europa « journaliste de l’année » en compagnie de sa consœur Katerina Bakhvalova (Andreyeva, de son nom de plume). Fin octobre, après sa libération, Daria Tchoultsova s’est rendue à Potsdam, en Allemagne, pour recueillir la prestigieuse distinction. Mais, sur scène, elle est montée seule. Car « Katia » croupit toujours « là-bas », derrière les barreaux. La journaliste de 29 ans a été condamnée arbitrairement, en juillet, à huit autres années de prison pour « trahison ». En allant chercher ce prix, Daria tenait à « rappeler à tout le monde » le sort de sa consœur.

Plus qu’une simple collègue ayant couvert avec Daria le mouvement de contestation inédit — déclenché par la fraude électorale d’août 2020 —, « Katia était comme une grande sœur ». « Nous formions un duo complémentaire. Elle était toujours portée à aller au cœur de l’action. Je suis plutôt introvertie, elle plutôt extravertie, nous nous complétions. Il est difficile de garder l’esprit clair dans l’intensité des conditions de travail dans lesquelles nous exercions, mais on y arrivait. »
La savoir loin d’elle, toujours enfermée, est pénible. « Je m’inquiète profondément de la savoir seule aujourd’hui. Je sais qu’il y a des gens formidables là-bas qui sont restés, bien sûr, et qui m’ont promis de la soutenir. Mais je ne sais toujours pas ce qu’elle ressent en ce moment. A-t-on même le droit de l’approcher ? Il fut un temps où personne n’était autorisé à communiquer avec elle… » La seule manière de maintenir ce lien ténu avec Katia, c’est par « par l’intermédiaire de son mari, et d’un avocat qui lui rend visite. » Lui envoyer des lettres se révèle vain. « Les autorités carcérales font de la rétention sur ce qui est transmis aux prisonnières. »
Chapitre premier. L’arrestation
15 novembre 2020. Au « square du changement », populaire quartier de Minsk, les deux jeunes reporters sont venues couvrir un rassemblement à la mémoire de l’opposant Roman Bondarenko, mort trois jours plus tôt, roué de coups par des hommes de main du régime. Le contexte est celui d’une répression tous azimuts s’intensifie au pays. Installées chez un particulier, depuis le 14e étage d’un immeuble, Daria et Katia filment pour le compte du média bélarussien Belsat la veillée, dispersée à grand renfort de grenades assourdissantes et de coups de matraque. Des dizaines milliers regardent leur retransmission en direct, des heures durant.
Puis, comme bien souvent depuis le début de la révolution démocratique, les autorités coupent le réseau Internet. Les deux journalistes sont repérées. Peut-être par un drone du régime survolant les lieux, supposera par la suite Daria. Elle se souvient encore du vacarme des forces antiémeute pénétrant dans l’immeuble, ou bien de la meule qui commençait à sectionner la porte derrière laquelle elles se terraient. « Nous avons assemblé tous les équipements et les avons placés dans un coin. Nous sommes allés dans la chambre avec le propriétaire, lumières éteintes. Sa femme était assise dans l’autre pièce avec les enfants. »
Une nuée de colosses de la police antiémeute s’introduisent dans l’appartement. « Ils ont commencé à nous illuminer avec leur lampe de poche. Nous n’avons pas résisté, cela ne servait à rien. Je n’oublierai jamais les cris de la femme du propriétaire : ‘‘mes enfants, s’il vous plaît, j’ai des enfants’’. Ils ont donc commencé à tout fouiller. Ils ne nous ont pas frappés, rien de tel ne s’est produit. Katia et moi avons été emmenées dans des voitures différentes jusqu’à poste. »
Chapitre deux. Le procès bidon
Daria et Katia ne se ont revues que des mois plus tard, en février 2021, au moment de leur procès, qui en avait ému plus d’un. Dans la cage des prévenus, au milieu de la salle d’audience, elles s’étaient enlacées, tout sourire, affichant le V de la victoire. « C’était pour nous moquer de ce système. C’était un moment absurde », explique Daria Tchoultsova. Une défiance à l’égard de ce verdict les accablant d’avoir « perturbé », par leur reportage, le fonctionnement des transports en commun minskois. Deux ans d’emprisonnement, et une amende de quelque 12 000 roubles bélarussiens (4 500 euros) pour avoir prétendument obstrué le trafic. Jamais, jusque-là, des professionnels de l’information n’avaient été condamnés aussi lourdement. Natallia Bouhouk, la juge à la solde du régime à l’origine de cette sentence, a depuis été ajoutée à la liste de personnalités sanctionnées par l’Union européenne.
Des regrets ? Daria Tchoultsova n’en a guère. « Pourquoi devrais-je m’apitoyer sur mon sort ? Ça n’a aucun sens. Je veux seulement continuer de faire mon travail. J’en suis même fière. Ce jour-là, le 15 novembre 2020, nous avons pu montrer pendant cinq heures ce cauchemar. Ce qu’on faisait en 2020, c’était simplement de dévoiler la vérité au grand jour. »
C’est à Chklow, petite ville de Mogilev, dans l’est du Bélarus, que Daria a grandi. Hasard de l’histoire, Alexandre Loukachenko a dirigé une ferme soviétique dans cette même région, au tournant des 1980. « Quand j’étais petite, il y avait plus de jeunes et de vie. La mort du pays commence par ces petites villes comme Shklow : les jeunes ne veulent pas rester et finissent par les quitter. Il ne reste plus personne qui souhaite travailler à sa prospérité et l’alcoolisme ronge la ville. »

Dès ses « neuf ans », Daria savait son chemin journalistique tracé. « Ça me surprend aussi. C’était comme une obsession, je ne me voyais pas ailleurs que dans ce domaine. » Ses proches ont longtemps tenté de l’en dissuader. Le pays n’est-il pas l’un des plus périlleux en Europe en matière de liberté de la presse, tel que l’atteste l’ONG Reporters sans frontières ? Rien n’a pu faire bifurquer Daria. « C’était le journalisme et rien d’autre. Ma maman a tenté de me convaincre de m’inscrire dans une autre faculté jusqu’au moment de soumettre ma candidature à l’université de Mogilev [à 30 kilomètres de Shklow]. » C’est pour un site d’information local que Daria commence ses premières armes en journalisme. « Nous faisions un reportage sur les habitants de Mogilev, les problèmes sociaux qu’ils rencontraient : des immeubles en décrépitude aux routes trouées. »
Chapitre trois. La vie en détention
Jusqu’à son procès et son purgatoire entre les murs de la colonie de Gomel, Daria aura été transbahutée d’un centre de détention à l’autre. Dont celui d’Okrestina, tristement célèbre pour les nombreux cas de torture qui en ont émergé et conditions de détention misérables. « Là-bas j’étais dans une toute petite cellule, conçue pour quatre personnes, je crois. À l’origine, nous étions six, puis rapidement, douze. Dans une pièce aveugle où empestait l’odeur des toilettes, enfin si l’on peut appeler ça des toilettes. Il faisait froid, humide en même temps. On dormait sur le banc, d’autres sur la table. On ne nous a donné un rouleau de papier toilette et un pain de savon. Je crois que nous sommes restées là quatre jours. »
En colonie pénitentiaire à Gomel, en dépit du harcèlement des autorités carcérales, Daria Tchoultsova refusa net tout mea culpa. « Tous les jours ou presque, c’était la même chose : ‘‘signe, signe, signe !’’, m’intimait-on. Mais pourquoi admettre des torts que je n’avais pas commis ? C’est comme le journalisme, j’étais obstinée. » Pressions psychologiques, rétention de lettres, limitation des visites… Les punitions pleuvent sur Daria. « En quatorze mois de colonie, on n’a autorisé que deux visites seulement de ma maman et ma sœur. » témoigne-t-elle.
Quand on la questionne sur l’apparence de l’édifice pénitentiaire, Daria Tchoultsova sort feuille et crayon. « La colonie est divisée en deux parties, dit-elle en dessinant la vue aérienne du site. Il y avait un point de passage, avec une énorme barrière, par laquelle les détenues traversaient au moment d’aller au travail le matin. Bloc par bloc, nous entrions dans la fabrique. »
« Quand je l’ai vue, elle arborait un sourire. Comme sur les photos de manifestations en 2020. »
Les « extrémistes » comme elle – c’est ainsi que sont qualifiés les prisonniers politiques dans les cachots bélarusses – dormaient à l’étage des lits superposés. Le plus dur à endurer ? Daria baisse la tête, et exhale un nouveau long soupir. « En fait, je déteste vraiment qu’on me donne des ordres. C’était leur manière d’exercer des pressions psychologiques sur les prisonniers politiques. »
Une prisonnière politique logeait à la même enseigne, et non des moindres : Maria Kolesnikova, musicienne et l’une des têtes d’affiche de l’opposition, mise sous écrou pour… « complots visant à s’emparer du pouvoir ». Elle a d’ailleurs été mise en cellule d’isolement, a appris récemment la presse indépendante bélarussienne. À la colonie n°4, Daria a pu l’apercevoir à quelques reprises, « à distance, un dimanche, à travers le grillage qui séparaient nos unités ». « Quand je l’ai vue, elle arborait un sourire. Comme sur les photos de manifestations en 2020. Nous avions l’interdiction de discuter, nous prisonnières politiques, avec elle. Elle est totalement isolée. Elle-même ne s’approchait de personne, elle faisait comprendre que mieux valait ne pas lui parler pour éviter les problèmes. »
Durant ses temps libres, Daria s’évadait par la lecture et, « quand l’humeur était au rendez-vous », s’attelait au dessin. Les moments à elle relevaient cependant de la rareté. Exit l’intimité au milieu d’un dortoir d’une trentaine de détenues, sept jours sur sept. « Ici, à Varsovie, on peut se réveiller, regarder par la fenêtre, voir la grisaille du matin et se dire qu’aujourd’hui, on n’aura pas envie de sortir, voire qu’on restera au lit. Mais là-bas, tu deviens robot en quelque sorte. Tu entends l’annonce du réveil, allongée, et tu te lèves soudainement (dit-elle en mimant le geste), tu t’habilles et tu te prépares pour aller au travail. On se lève, on s’habille et, si le temps le permet, on fume cigarette avant le travail. » Le réveil, fixé à 6 heures, précédait le boucan des machines à coudre du quart de travail journalier. S’y soustraire, c’était de facto faire le choix de la cellule d’isolement. Daria Tchoultsova n’est jamais allée jusque-là. « J’ai priorisé ma santé, explique-t-elle. Pour ne pas se laisser envahir par les pensées négatives, on s’accroche à la routine, sans réfléchir. »

Enfiler l’uniforme, d’abord. « C’était le plus souvent une robe ou un tailleur, et une veste quand il faisait froid, avec un insigne sur la poitrine comportant photo, prénom, article et année d’accusation. » En colonie pénitentiaire pour femmes, le pantalon demeure interdit. Les « individus ayant un penchant vers l’extrémisme » — entendre, les prisonniers politiques — étaient distingués des autres.« J’ai passé deux étés là-bas. Il faisait très chaud, et cet asphalte chauffant sous le soleil rendait l’atmosphère insupportable. Certaines perdaient connaissance. Et malgré cela, nous devions rester 20 à 30 minutes en rang, immobiles dans cette chaleur, avant de regagner notre unité après le travail. L’hiver est aussi dur à sa manière. Le froid nous empêchait parfois de dormir. L’obscurité, la neige, l’air glacial… En colonie, peu d’entre nous aiment l’hiver. »
L’ambiance de l’atelier à coudre n’est pas plus réjouissante.Un travail forcé de six heures par jour « où tout le monde crie, prisonnières comme gardiens, avec le bruit incessant des machines en arrière-plan. On sortait de là avec la tête lourde. Il y avait une pause pour fumer et 30 minutes pour manger. Si certaines n’arrivaient pas à accomplir leurs tâches dans les temps, on leur criait dessus, même les débutantes. Au troisième jour de détention, on exige que tu sois totalement opérationnelle. Les cris, ça faisait partie de la routine. »
Il était toutefois de ces moments qui réchauffent le cœur. Comme la fois où, alors qu’elles étaient logées séparément, elle a croisé Katia. « J’ai pu lui faire un câlin », s’émeut Daria. C’était un dimanche, jour de congé en colonie, à la sortie de la salle de cinéma de la colonie. « C’était bonheur de revoir Katia, cela faisait plus d’un an que je ne l’avais pas vue. Elle était contente de me revoir aussi. Elle a fait le signe d’un cœur avec ses mains. »
Aussi Daria s’est-elle liée d’amitié avec d’autres détenues. Des relations qui lui ont permis de tenir le coup. « L’une d’elles est censée sortir bientôt de détention », se réjouit Daria, avant que son visage ne se referme aussitôt : « mais il reste encore trois ans à une autre amie, en espérant que ça se termine avant. »
Avec chacune des détenues, Daria tentait de trouver un « langage commun ». Le portrait sociologique de la colonie de Gomel ? « Il y avait des prostituées, des femmes accusées de consommation de drogues, d’autres, emprisonnées pour ne pas avoir payé des pensions alimentaires après des divorces… Des histoires de fraude et de corruption, si l’on peut appeler cela ainsi. Certaines sont enfermées, par exemple, pour avoir donné une barre de chocolat en guise de ‘‘pot-de-vin’’… La plupart de celles accusées de crimes ‘’économiques’’ étaient des comptables, des gens assez éduqués. Pour les mamans accusées de ne pas avoir payé de pension, elles sont aux prises avec l’alcool, ne travaillent pas, n’ont pas de diplôme. Il y a une différence énorme parmi les populations de la colonie. Celles qui sont par exemple accusées d’homicide ont pour la plupart tué leur mari dans un élan de légitime défense se protégeant d’un accès de violence. Mais au Bélarus, cela n’est pas vu ainsi : le procès ne favorise jamais la femme. »
« Un petit cercle de prisonnières politiques discutait, et j’ai entendu le mot ‘’guerre’’. C’était pour moi un mélange de tristesse et de désespoir, un état de choc ».
Les lettres de ses proches ou de simples citoyens ont été l’autre source de réconfort de Daria. En a-t-elle reçu une qui la particulièrement marquée ? Daria retient une larme, sa gorge se noue. « J’en ai reçu tant… Du genre : ‘‘on te soutient, on attend ta libération, on veut que tu sortes de là le plus vite possible’’. Des correspondances se sont entamées. J’ai beaucoup appris sur la vie de ces personnes qui m’écrivaient ; c’est cela qui m’a touchée le plus. Ces gens me parlaient de leur vie, de leurs émotions, de leur quotidien. Ils ne me demandaient pas comment je me sentais, mais entretenaient un dialogue. Cela permettait de changer d’univers. Moi, dans ces lettres, je racontais moins mon quotidien mais on discutait de livres, de films, de moments humains, de voyages… de la vie, tout simplement. Et le plus chouette, c’est qu’après, une fois libérée, on peut revoir ces personnes, en vrai. »
Les lettres ont afflué un temps, puis drastiquement chuté lorsqu’est survenue la guerre en Ukraine. « On ne pouvait recevoir que de la famille. » C’est au détour d’une conversation, lors d’une pause cigarette avant de rejoindre l’atelier de couture, que Daria a appris l’invasion russe du 24 février 2022. « Un petit cercle de prisonnières politiques discutait, et j’ai entendu le mot ‘’guerre’’. C’était pour moi un mélange de tristesse et de désespoir, un état de choc », explique celle qui porte « Kyïv dans son cœur ». « Il est dur d’anticiper ce genre d’information lorsqu’on est sans accès au monde extérieur. On discutait chaque jour de la guerre en prison ».
S’informer sur l’actualité entre les murs de la colonie pénitentiaire relevait du défi. « Il fallait beaucoup filtrer ce que la télévision d’État en disait. Une propagande aussi simpliste, c’est difficile à regarder, ça me donnait la nausée. Il fallait renverser le discours des médias gouvernementaux pour avoir une meilleure idée de la situation. C’était comme résoudre une énigme écœurante. » Les rencontres entre certaines prisonnières et leur avocat permettaient également de se faire ébruiter des informations. « Dans les lettres, on codait aussi des messages pour s’informer sur la situation en Ukraine, et quand maman a pu venir me voir lors de ses rares journées de visite, nous n’avons parlé que de ça. » Des désaccords en lien avec le conflit ont pu surgir entre détenues, certaines soutenant la rhétorique du Kremlin et du despote de Minsk. « Il faut comprendre que certaines sont enfermées là-bas depuis très longtemps déjà, voire des années. Abreuvées de propagande, leur esprit critique s’est complètement dissipé, et il était difficile de les convaincre. Celles qui pouvaient encore réfléchir normalement avaient une vue d’ensemble plutôt fidèle à la réalité, même si elles disposaient d’une information minimale. »
Et quid de l’alimentation ? Que servait-on à la cantine de la colonie ? Voilà l’un de ces épisodes de sa vie carcérale qu’elle préfère taire. « Pour éviter de faire remonter ces souvenirs », de justifier la jeune femme. Mais la pastèque offerte par un collègue le jour de sa remise en liberté, et dans laquelle elle a croqué à pleines dents, elle en parle volontiers.
Chapitre quatre. La libération
Les quelques semaines passées au Bélarus avant son départ déchirant pour la Pologne, Daria s’est fait reconnaître plusieurs fois dans la rue. « Certains demandaient la permission de m’embrasser, un homme m’a offert une rose. Moi, une héroïne ? Que répondre à cela ? C’était si bizarre. Je m’attendais à être accueillie à bras ouverts, certes au vu nombre de personnes qui m’écrivaient. Et les gens écrivaient aussi à maman… » Daria estime qu’au moins « un millier » lettre lui a été transmises. Mais c’est sans compter celles qui ont fait, sans doute, l’objet de rétention par l’administration pénitentiaire. « Ma mère me demandait si j’avais reçu la lettre de telle ou telle personne, ce qui n’était pas toujours le cas. Où sont passées ces lettres ? Nul ne le sait. Un expéditeur m’a dit m’avoir écrit 11 ou 12 lettres, quatre seulement me sont parvenues. »
« En restant au Bélarus, je n’aurais pas pu continuer de faire mon travail, ni même donner cette interview. »
La première chose qu’elle a faite, le 3 septembre, en sortant du camp de travail… « C’est d’aller au magasin. Je suis allée m’acheter des produits de soin, des masques, des shampoings. Maman parlait au téléphone, annonçait à tout le monde ma sortie. Le truc, c’est que je ne savais plus comment faire pour payer avec ma carte ! »
Au fur et à mesure que le jour sa libération approchait, une « paranoïa » grandissait chez Daria. « Les gardes se faisaient un plaisir sadique à me dire que je suivrais la voie de Katia. J’ai pu croire à ma libération qu’au moment où j’ai pu enlacer mes proches à la sortie du centre. Si les prisonniers ressentent d’habitude une euphorie en sortant de détention, c’est plutôt avec peur que j’ai gouté de nouveau à la liberté. » Car une crainte la tenaillait : et si on l’arrêtait de nouveau, sur un autre prétexte ? « C’est en quelque sorte pour cela que j’ai choisi l’exil. Déjà, chaque fois que je voyais une voiture de police, je commençais à courir ou à me cacher. Cette appréhension qu’on toque à la porte de mon appartement pour venir m’arrêter m’habitait encore. En tant que journaliste, je veux continuer de porter ma voix et parler des problèmes qui sévissent dans mon pays. En restant au Bélarus, je n’aurais pas pu continuer de faire mon travail, ni même donner cette interview. »
Chapitre cinq. L’exil
L’angoisse ne l’a quittée qu’au moment de traverser la frontière polonaise, fin septembre, une fois son visa humanitaire en poche. Pour éviter de susciter toute interrogation, elle a effacé tout « détail potentiellement compromettant » sur son téléphone. Elle n’a pas emporté avec elle objets ou livres classés « extrémistes » par le régime. Les lettres qu’elle a reçues en détention, Daria les a aussi laissées sur place. « J’avais peur que les gardes-frontières me fouillent. » Quitter son pays, sa famille, pour une période indéfinie a été un déchirement. Mais un soulagement, aussi. « Le poids imaginaire que j’avais sur mes épaules est tombé. C’est un soulagement de savoir que personne ne t’espionne, te suit à la trace. »
À Varsovie, elle a renoué avec son travail à la rédaction de Belsat, basée dans la capitale polonaise. « Faire du journalisme en exil, c’est tenter de continuer d’informer les Bélarussiens : soit avec des gens sur place qui relaient des informations, soit avec les rares journalistes au Bélarus qui opérent en catimini. Je n’arrive pas à concevoir comment ils peuvent travailler dans de telles conditions. »
La Daria de 23 ans incarcérée il y a deux ans n’est pas la même d’aujourd’hui. Elle s’est endurcie. « Et ça peut paraitre bizarre, mais je suis devenue plus sociable. J’ai appris à parler ouvertement de mes pensées, mes émotions. Auparavant, je les cachais », confie-t-elle. « Mais on ne peut pas dire que j’ai gâché deux ans de ma vie. Des fois, quand la déprime prend le dessus, je le pense, certes. Deux ans, c’est tout de même beaucoup. Mais, avec du recul, je me refuse à penser comme ça. J’ai tout de même récolté beaucoup d’informations durant cette épreuve. Comme si j’avais mené une enquête. Et maintenant, je compte utiliser ces informations d’une manière ou d’une autre. Il faut essayer d’en sortir quelque chose de bien. » L’écriture d’un livre ? Daria sort sa carte Joker. « Information confidentielle », dit-elle, sourire en coin.
Changer, mais aussi apprendre sur soi-même. De ces deux ans de prison, elle en tire une introspection qui en est toujours à ses balbutiements. « J’ai réalisé que je suis une personne assez stoïque… » Et qu’elle tenait mordicus à défendre les principes qu’elle chérit. « Je ne me soumets pas quand on me fait chanter. J’ai appris aussi l’importance de pouvoir compter sur mes proches. Là-bas, j’ai compris le besoin de m’entourer. »
Daria l’admet, elle se permet « de temps en temps » des grasses matinées. Les premières semaines de sa libération, ses réflexes de détenue la hantaient toujours. Certains matins, elle se réveillait à heure fixe, tôt le matin, comme en colonie. « Tout de suite je me levais, je m’activais, je ne pouvais pas rester dans mon lit. Maintenant, petit à petit, je commence à me détendre. » En Pologne, une aide psychologique lui a été proposée. Elle ne souhaite pas en profiter, pour le moment du moins. « Beaucoup de personnes ont tenté de s’insérer dans ma tête ces deux dernières années. J’aimerais me laisser un peu de temps, et éviter qu’une autre personne y entre à son tour. » Le sentiment de ne pas avoir quitté tout à fait l’enceinte verte opaline de la colonie n° 4 persiste, tout de même. « Parfois, il m’arrive de regarder l’heure et de me dire “en ce moment, les filles font ci ou cela”, avec un sentiment de culpabilité. » Il est justement 13 heures, à la fin de notre rencontre. « Là, les filles viennent de rentrer du déjeuner. » Et prennent la direction de l’atelier de couture.
Article publié avec le soutien de Heinrich Böll Stiftung | Bureau Paris – France.