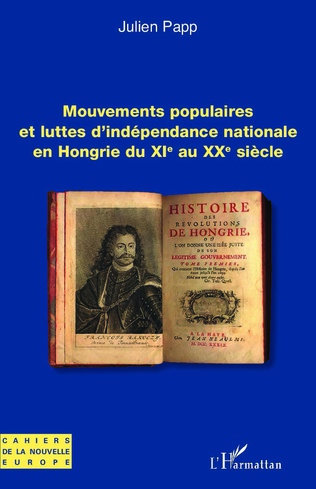Julien Papp est un historien d’origine hongroise. Installé en France depuis les années 1960, il publie chez L’Harmattan un volume intitulé Mouvements populaires et luttes d’indépendance nationales en Hongrie du XIe au XXe siècle. Entretien.
Le Courrier d’Europe centrale : Pouvez-vous en premier lieu nous décrire en quelques mots votre trajectoire personnelle et professionnelle. Quand, et dans quelles conditions avez-vous quitté la Hongrie ? Pourquoi avoir choisi la France comme terre d’accueil ? Ce parcours a-t-il guidé votre choix de faire de l’histoire votre métier ?
Julien Papp : Je suis venu en France en septembre 1965, à l’occasion d’un voyage touristique Paris-Versailles de dix jours. La veille du retour, j’ai quitté le groupe en compagnie d’un jeune architecte dont j’avais fait la connaissance dès le début de notre séjour. Après des démarches laborieuses, nous avons obtenu le statut de réfugié politique, mais les premiers mois furent très difficiles. Mon compagnon ne parlait pas la langue, moi, je pouvais dire pas mal de choses mais sans bien comprendre ce que disaient les Français. C’est en janvier 1966 que j’ai trouvé un travail stable, permettant notamment de suivre les cours de l’Alliance française. À la rentrée de 1967, je me suis inscrit à la Sorbonne en Sociologie et j’ai fini par obtenir une licence en cette matière, puis en Histoire-Géographie en 1973, ce qui m’a permis de faire des remplacements dans divers établissements de l’enseignement public. Entre-temps, j’ai obtenu la nationalité française, tandis que, en Hongrie, on m’a condamné à deux ans de prison pour refus de retour. C’était assez éprouvant pour ma famille, et pour moi aussi car pendant plus de dix ans je n’ai pas pu retourner dans le pays.
Dans mon « évasion », il y avait une dose d’esprit d’aventure, et surtout l’image et les connaissances que j’avais de Paris, comme pour bien d’autres étrangers attirés par cette ville. On peut parler d’une sorte de mythologie. Dans mon enfance, j’avais beaucoup lu Jules Verne puis d’autres auteurs du XIXe siècle. La vie de bohème et le passé révolutionnaire de Paris me séduisaient particulièrement, en sorte que ce fut une certaine imprégnation par l’histoire qui m’a conduit vers la France. Plus profondément, cette imprégnation se nourrissait de l’expérience, puisque mes premiers souvenirs remontaient à l’automne 1944-printemps 1945, marqués par le passage de la guerre en Hongrie ; par ailleurs, j’ai vécu dans une paysannerie que l’histoire a si souvent malmenée.
L’approche savante, si je peux le dire ainsi, est liée à mon recrutement en 1977 comme correspondant départemental du Comité d’histoire de la deuxième guerre mondiale (CH2GM). Ce comité est né en 1951 de la fusion de la Commission d’histoire de l’Occupation et de la Libération de la France et du Comité d’histoire de la guerre, créés respectivement en octobre 1944 et juin 1945. La Commission était attachée au ministère de l’Éducation nationale et le Comité au Premier ministre, comme l’organisme successeur, le CH2GM. Celui-ci a laissé la place en 1980 à l’Institut d’histoire du temps présent (IHTP), qui, de son côté, dépend du CNRS. Dans les enquêtes des correspondants, tous les aspects de la guerre et de l’occupation étaient abordés. Ainsi, le CH2GM avait mis en place huit commissions thématiques : déportations, prisonniers de guerre, histoire militaire, Résistance, collaboration, économie, colonies, rôle de l’Église. L’IHTP allait élargir le domaine des enquêtes, notamment sur l’étude des mémoires, de la police, des municipalités, de la pénurie, ou encore du passage de la IVe à la Ve République, pour ne citer que les enquêtes auxquelles j’ai participé jusqu’en 2000, où j’ai pris ma retraite de l’Éducation nationale. Pour discuter en particulier de l’état des sources et des questions de méthode, le Comité et l’IHTP convoquaient régulièrement des réunions à Paris ou dans les centres régionaux.
Par ailleurs, des correspondants en assez grand nombre prolongeaient leurs travaux sous forme de thèses et de diverses publications. Moi-même, j’ai soutenu une maîtrise sur la collaboration politique, et ce travail, ainsi que mon enquête sur la résistance ont donné lieu à des livres. Dans mes activités, surtout pour obtenir des dérogations et l’accès aux documents sensibles, j’ai été soutenu par Marcel Baudot, directeur des archives départementales de l’Eure depuis 1925, résistant dès 1940 et chef des FFI, puis Inspecteur général des archives de France à partir de 1949.
En 2006 a paru aux presses universitaires de Rennes votre thèse soutenue en 2002, sous le titre La Hongrie libérée. État, pouvoirs et société après la défaite du nazisme (septembre 1944-septembre 1947). Pourquoi vous être intéressé à cette période spécifique de l’histoire hongroise et à quelles conclusions êtes-vous parvenu dans ce travail ?
Parallèlement à mes recherches dans le département, je terminais en 1990 un DES à la Sorbonne avec les professeurs René Girault et Bernard Michel, ce qui me mena à revisiter la Hongrie sous forme d’une thèse. L’histoire de mon pays d’origine était restée en éveil en quelque sorte, dans la mesure où depuis les années 1980 je publiais des articles de vulgarisation sur la Hongrie, dans Gavroche. Revue d’histoire populaire. En ce qui concerne la thèse, il me semblait intéressant de retrouver en Hongrie le même sujet que je fouillais depuis des années dans un département français, intéressant aussi de découvrir tout ce qui se passait autour de moi et dans le pays quand je n’avais que 4-7 ans.
Les Occidentaux pouvaient compter sur la main de fer de Staline pour maintenir l’ordre dans sa sphère d’influence, et eux-mêmes, sur le Plan Marshall pour éviter l’explosion, en France notamment.
Quant aux conclusions, j’ai cherché à les problématiser, non sans me livrer constamment à une introspection, pour deux raisons au moins : d’une part, les années de la dictature stalinienne et tout le régime abhorré par ma famille n’auraient pu que m’entraîner à faire mon travail sous le poids de mon vécu personnel ; d’autre part, comme j’ai fait à Paris, par anti-stalinisme, un bout de chemin dans le mouvement trotskyste, où on ne jurait que par la révolution mondiale, je devais me demander si cette vision ne continuait pas à peser sur mon jugement et sur l’élaboration de la matière documentaire (bien que je ne fusse dans l’organisation trotskyste qu’une sorte de Frédéric Moreau sur les barricades).
Mes recherches m’ont conduit cependant à considérer en dernière instance la thématique révolutionnaire comme un facteur décisif. À savoir que la hantise majeure et pour Staline et pour les Occidentaux était que la guerre s’achève par une vague révolutionnaire encore plus puissante que celle des années 1917-1923 ; plus puissante, car un peu partout on avait affaire à des mouvements de résistance organisés, qui avaient des projets sociaux et politiques. Plus que jamais pouvait donc s’appliquer ce que Metternich écrivait en 1832 au comte Apponyi : « Il n’existe en Europe qu’une seule affaire sérieuse et cette affaire, c’est la Révolution ». Dans notre cas, et sans tomber dans le complotisme, les Occidentaux pouvaient compter sur la main de fer de Staline pour maintenir l’ordre dans sa sphère d’influence, et eux-mêmes, sur le Plan Marshall pour éviter l’explosion, en France notamment. Les États-Unis d’Amérique en avaient les moyens…
Mais, malgré ce contexte, tous les pays occupés par l’armée soviétique n’avaient pas la même importance pour Moscou. Du point de vue géopolitique, la Hongrie et la Tchécoslovaquie étaient des pays marginaux par rapport au « couloir » germano-polonais et aux pays balkaniques. Certes, les Soviétiques ont miné le terrain en installant partout leurs « conseillers » du NKVD (et arrêté dès février 1947 le secrétaire général du parti des Petits propriétaires, Béla Kovács, qui visiblement était trop pressé et croyait trop au Père-Noël, pour le dire familièrement). Mais vu la durée et l’extraordinaire ambiance de liberté de la « transition démocratique », je pense que c’était dans la perspective du « wait and see », car, évidemment, il était impensable que Staline ne fût prêt à toute éventualité. Or les Tchèques ont trop flirté avec le Plan Marshall, et les Hongrois avec la guerre civile (tant les forces de l’ancien régime étaient convaincues que « les Russes » partiraient, on règlerait les comptes des communistes et tout serait comme avant) pour qu’une solution éventuelle à la finlandaise fût possible. J’ai retrouvé par la suite cette idée chez un auteur britannique, Steward Steven qui, relatant les manigances de Dulles après la guerre, a estimé que les deux pays en question auraient pu devenir les alliés et non pas des colonies de l’URSS.
Spécialiste du XXe siècle – vous avez également publié en 2013 aux presses universitaires de Dijon le livre Espoirs et violences de la Hongrie au XXe siècle – vous embrassez avec ce volume consacré aux luttes populaires et nationales une période bien plus large, en commençant votre démonstration à l’époque médiévale. Pourquoi ce choix ? Quel continuum distinguez-vous dans ces phénomènes insurrectionnels ou révolutionnaires jusqu’au XXe siècle ?
Il n’y a pas de thèse dans ce livre, donc pas de démonstration à proprement parler, sinon une motivation : réagir à la logique impériale de l’européisme ambiant, en rappelant par le truchement de la connaissance historique le combat multiséculaire du peuple hongrois contre cette logique qui, en réalité, ne fut chaque fois que la justification des puissances dominantes pour imposer leur raison d’État et les intérêts nationaux du pays autour duquel l’empire s’organisait. Mon travail voulait être une histoire de la Hongrie vue d’en bas, un récit appuyé sur quelques-uns des meilleurs auteurs du pays. On aurait voulu adopter un point de vue différent des livres francophones qui très souvent portent sur l’histoire politique générale de la Hongrie. Ce cadre est loin d’être absent dans mon livre, qu’il s’agisse des références nationales ou internationales. L’idée sous-jacente est que, par exemple, on ne peut pas comprendre Voltaire sans connaître l’histoire de l’Église et du cléricalisme.
À quels événements vous intéressez-vous plus spécifiquement ici ? Comment avez-vous choisi les événements que vous avez étudiés ?
Comme je le dis également en introduction, les événements étudiés ont été retenus en fonction de leur importance dans l’historiographie hongroise savante et dans la mémoire populaire, ainsi que dans les créations artistiques (poésie, littérature, musique, etc) ; en fonction aussi de leur caractère de phénomène collectif, ce qui explique que des brigands légendaires du peuple mais isolés, comme Sándor Rózsa ou Márton Vidróczki sont absents de l’ouvrage.
Vous distinguez dans votre titre « mouvements populaires » et « luttes nationales ». Pourquoi ce choix et quelles relations peut-on établir entre ces termes et les phénomènes historiques qu’ils recouvrent ?
Ces relations sont très visibles. Pour ne citer que les plus marquantes, dans sa lutte contre l’Autriche, le prince Bocskai fut suivi par les paysans aspirant à des privilèges qui leur permettraient d’échapper aux conditions serviles. Lors des soulèvements incarnés par Rákóczi et Kossuth, les recrutements populaires ont décliné quand la paysannerie n’a pas vu changer sa condition sociale. En octobre 1956, l’exigence du départ des troupes soviétiques et la réintégration de la pleine souveraineté apparaissaient d’emblée inséparables de la fin des livraisons obligatoires et de la collectivisation forcée ; dans la classe ouvrière (qui existait encore), et en général pour la majorité de la population l’indépendance nationale était liée à la défense du système nationalisé des usines, des banques et des ressources. Au demeurant, aussi loin que l’on remonte, la cause de la liberté au sens large restait consubstantielle à celle de l’indépendance et de l’émancipation sociale.
Le souvenir des luttes populaires ne fait pas bon ménage avec la résurrection de l’idéologie dite chrétienne nationale de l’entre-deux-guerres, qui cherche à redorer le blason et la chasuble des classes dominantes de la Hongrie seigneuriale.
À partir de quel moment peut-on commencer à parler de l’émergence d’une nation hongroise ? Naît-elle seulement dans l’affrontement ou aussi selon d’autres modalités ? Quel rôle jouent les classes populaires dans ce mouvement ?
La nation en Hongrie (comme en France aussi) est l’objet de débats inépuisables. Pour le médiéviste Gyula Kristó, qui un moment a fait le bilan de ces débats, l’existence d’une nation hongroise médiévale reste une question ouverte. On peut parler à la rigueur de conscience individuelle et de liens affectifs. Comme phénomène collectif, la genèse de la nation peut être envisagée selon quatre caractéristiques : la haine de l’étranger, le passé commun, le cadre étatique (qui inclut la population de son territoire indépendamment de sa langue, ses habitudes et ses origines) et la notion abstraite de patrie qui change celle de terre natale. En tout cas, affirme l’historien, la nation hongroise est née au XIIIe siècle, « ni avant ni après ». Notons que les facteurs indiqués ne devraient pas être pris dans un ordre chronologique étroit, puisque la haine de l’étranger se retrouvera dans les « kouroutzeries » (kuruckodás) du nationalisme chauvin de la noblesse hongroise (tant détestées par le poète Endre Ady notamment, se considérant comme le véritable héritier des kouroutz et le « triste petit-fils » de György Dózsa), et presque au même degré que la fureur élémentaire des Hongrois semi-païens du XIe siècle, se levant contre « des Allemands qui hurlaient comme des bêtes sauvages et des Italiens qui jacassaient et gazouillaient comme les hirondelles » dévorant les biens de la terre.
Quelles mémoires les Hongrois gardent-ils de ces épisodes ? Sont-ils aujourd’hui notamment convoqués dans le débat public et politique ? Par qui ? De quelle façon ?
La guerre des mémoires, la politique mémorielle font rage en Hongrie et la presse consacre des pages aux « falsifications de l’histoire ». L’affaire tourne surtout autour de la Seconde Guerre mondiale, mais l’antagonisme kouroutz-labanc réapparaît aussi avec la dépréciation par le camp pro-Habsbourg des luttes d’indépendance des siècles passés. Et avec l’européisme, ils ont le vent en poupe. Par ailleurs, le souvenir des luttes populaires ne fait pas bon ménage avec la résurrection de l’idéologie dite chrétienne nationale de l’entre-deux-guerres, qui cherche à redorer le blason et la chasuble des classes dominantes de la Hongrie seigneuriale. Il me semble cependant que localement, les habitants et les autorités continuent à honorer leurs héros populaires comme György Dózsa, János Szántó Kovács, István Várkonyi, András Áchim… C’est un fait aussi que les monuments, stèles, bustes, etc, érigés à la mémoire des leaders paysans et autres (pour la plupart à l’époque communiste) n’ont pas été affectés par le « nettoyage » du paysage sémantique poursuivi par le nouveau régime.
Propos rapportés par Matthieu Boisdron.